Et c’est parti pour le Festival OFF d’Avignon 2025. Comme chaque année, je vous partage sur Esperluette en Mode Festival mes rencontres, mes coups de cœur, mes découvertes artistiques et humaines ! A suivre tout au long du mois de juillet.
Cliquez sur le titre du spectacle pour écouter l’interview ou lire ma chronique
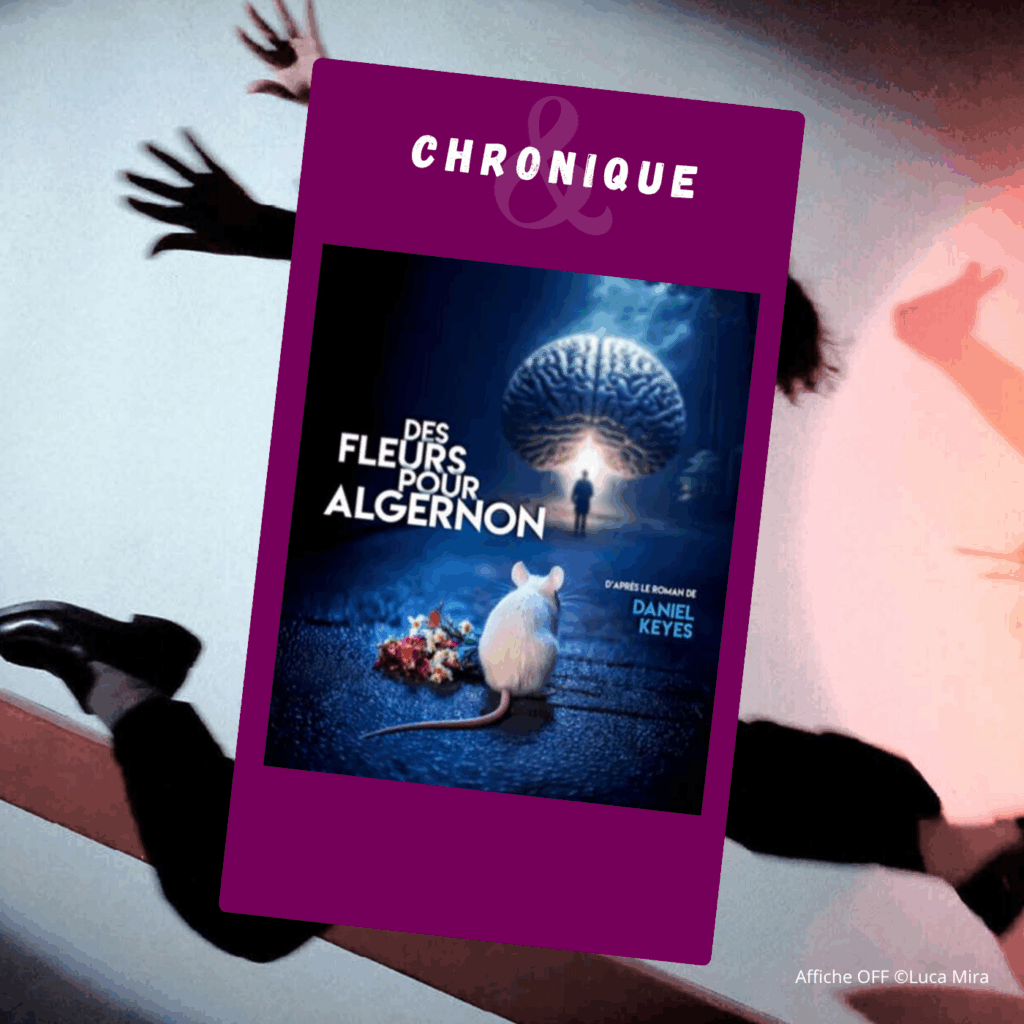
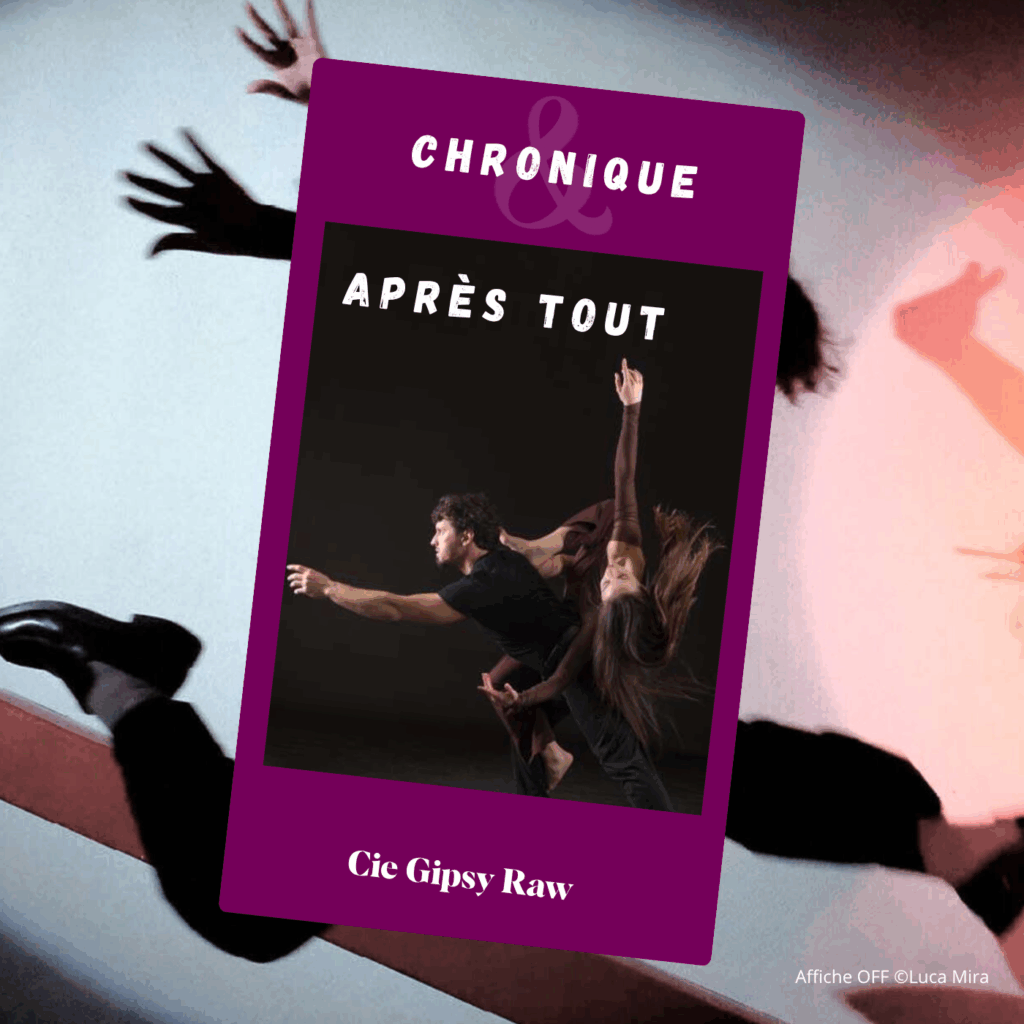
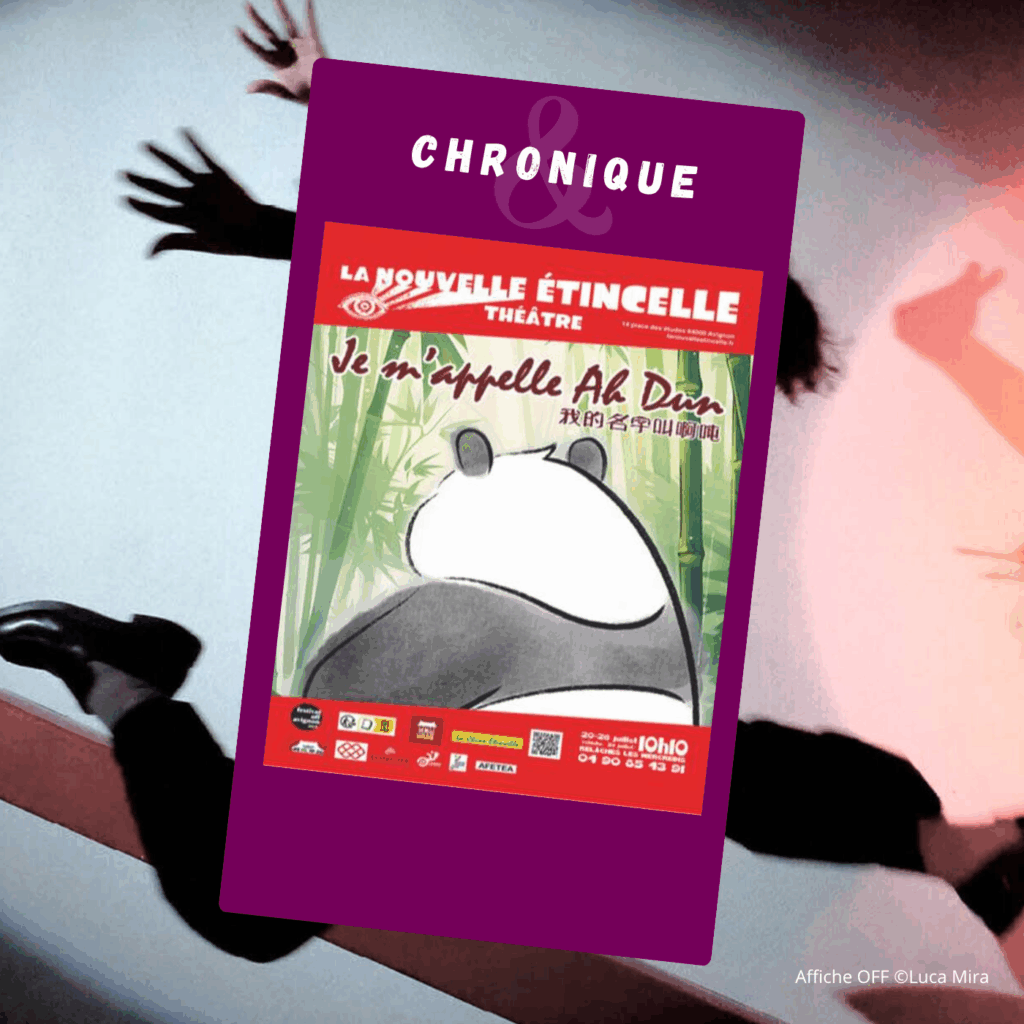
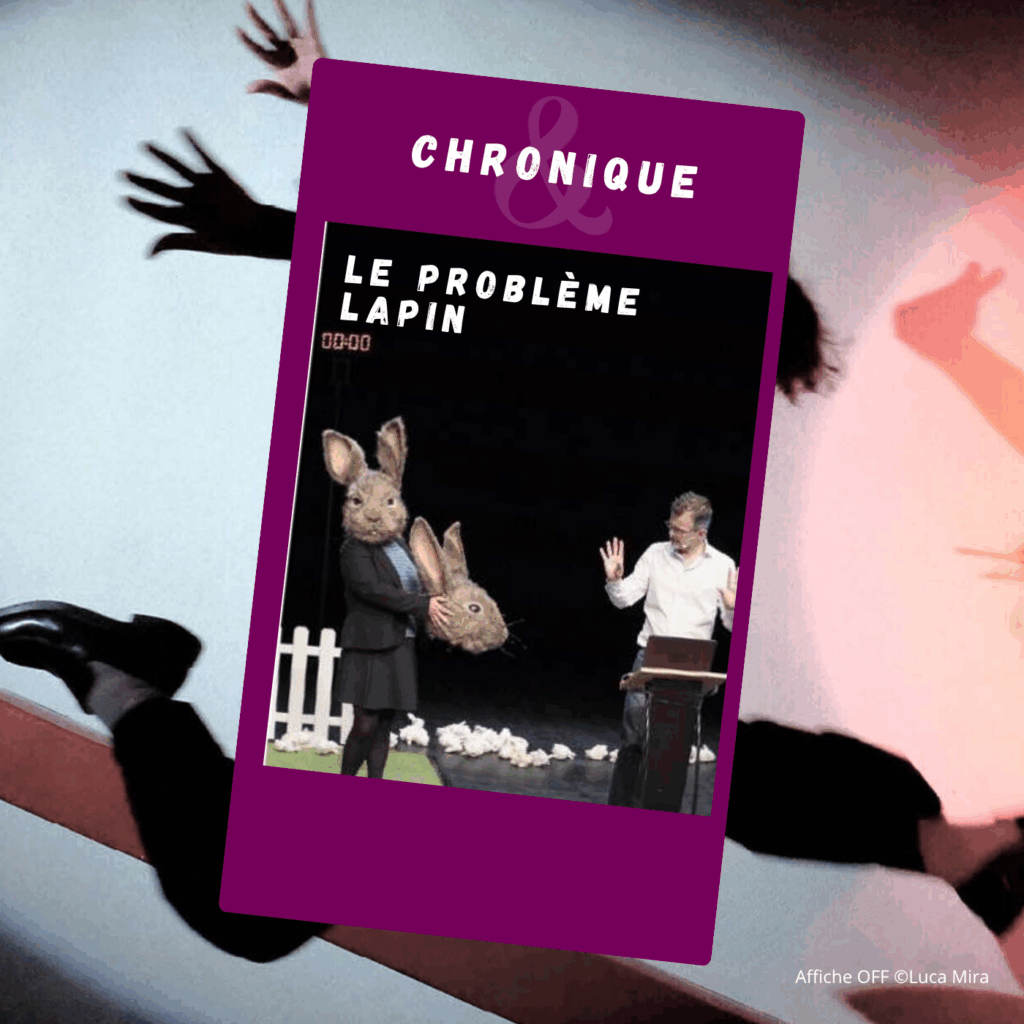
Mon avis sur le spectacle
Pour mon avant-dernier jour de Festival, j’ai suivi les conseils de mes invités et j’ai vu Des fleurs pour Algernon…
À la fin de la pièce, une, deux, puis plusieurs personnes se sont levées. Et moi, non.
Pas parce que je n’avais pas aimé, bien au contraire. Parce que j’étais en train de respirer après cette performance que je venais de voir. Il m’a fallu du temps pour laisser redescendre ce que j’avais ressenti. C’est étrange parfois, ce moment juste après un spectacle, quand les émotions ne sont pas encore passées mais que les lumières se rallument. On aimerait rester encore un peu plus dans ce siège, juste quelques minutes… mais ce n’est pas vraiment possible à Avignon. Alors je me suis levée, les yeux qui commençaient à s’humidifier — mais c’était trop tard pour que les artistes le voit.
Parce que Des fleurs pour Algernon, ce n’est pas juste un seul en scène porté avec beaucoup d’intensité et de finesse par William Mesguich. Il n’est d’ailleurs pas seul sur scène : il est accompagné par deux musiciens – Amélie Stillitano et Raphaël Simon – qui occupent, avec leurs instruments, une grande partie de l’espace. Cela crée une vraie proximité entre le public et l’acteur, qui se confie à nous, bougeant à peine de sa chaise.
Un espace scénique réduit, presque étouffant, qui donne cette impression que le personnage est enfermé dans sa boîte. Comme Algernon, cette souris qui partage le destin du personnage principal.
Dans cette pièce, adaptée du roman de science-fiction écrit par Daniel Keyes, on suit le parcours un peu vertigineux de Charlie Gordon, un homme simple d’esprit à qui l’on propose de subir une opération pour décupler son intelligence. Une quête de normalité, qui le mènera vers une quête de perfection, censée le rendre plus heureux.
Mais au fond, qu’est-ce qu’être intelligent ? Est-ce que cela permet réellement d’être plus accepté par la société ? Et que perd-on quand on oublie d’apprécier ce que l’on a déjà ?
C’est ce qu’interroge ce texte, et ces questionnements restent bien présents après la pièce.
La mise en scène montre aussi qu’on n’a pas besoin de grands décors ou de beaux costumes pour capter l’attention du public.
L’intensité ne passe pas forcément dans les cris ou les portes qui claquent, mais dans le talent des artistes (et j’intègre ici les musiciens, qui apportent à la pièce une ambiance très particulière et participent à cette sensation d’être constamment en tension, comme le personnage), dans des mouvements savamment pensés, dans des regards et des silences, dans un texte fort et une intention placée juste là où il faut.Cette version de Des fleurs pour Algernon travaille de l’intérieur, à son rythme, et laisse doucement sa trace en nous.
Et j’aime beaucoup ce genre de théâtre.
Mon avis sur le spectacle
Qu’est-ce qui fait qu’un spectacle de danse nous touche vraiment ?
C’est ce moment où une énergie surgit du mouvement, de la musique, d’un regard…
Et Après tout en est un très bel exemple.
Manon Mafrici et Pasquale Fortunato, duo de la compagnie franco-italienne Gipsy Raw, mêlent dans Après tout danse urbaine, contemporaine, contorsion et quelques touches de magie lumineuse.
Sur scène, c’est la rencontre de leurs univers techniques différents, mais aussi leur fusion, qui nous entraîne dans une réflexion sur le temps.
Le décor est minimaliste : un grand sablier trône à droite de la scène. Mais dès les premières minutes, on est attiré par ces deux corps qui s’attirent et se répondent.
J’ai eu des frissons, j’ai été émue, amusée même, et surtout touchée par cette écriture, par la musique parfaitement choisie, par ces petites lumières de vie qui virevoltent entre les deux danseurs — comme un souffle magique qui nous embarque.
C’est un spectacle où l’on sent la perfection technique des artistes, bien sûr, mais c’est surtout ce qu’ils dessinent ensemble qui nous capte, mêlant les disciplines sans vouloir en faire trop, juste ce qu’il faut. Aucun des deux ne passe au-dessus de l’autre, ce qui donne une constante impression de fluidité, même quand les tableaux expriment quelque chose de plus dur, de plus brut.
Leurs énergies et leurs talents sont liés pour notre plus grand plaisir, et pendant ces cinquante minutes — que l’on aimerait plus longues — on est suspendu à leurs souffles, à leurs gestes, à ce qu’ils nous racontent.
La scène devient un micro-moment, un instant partagé tous ensemble, public et artistes, dans nos vies intenses. Et ce court instant, où l’on applaudit, vient saluer tout le travail qu’il a fallu pour créer un si beau spectacle.
J’espère pouvoir découvrir d’autres créations de ces deux danseurs et chorégraphes aux talents fous, bientôt à Avignon.
Mon avis sur le spectacle
Parfois, au Festival d’Avignon, on a besoin d’un petit souffle de fraîcheur et de poésie pour bien commencer la journée. C’est exactement ce que m’a offert le spectacle Je m’appelle Ah Dun.
Je suis sortie de la salle avec une vraie bouffée d’optimisme, un peu comme si on avait rouvert la porte de mon imaginaire d’enfant.
Alors c’est quoi, ce spectacle ? C’est l’histoire d’Ah Dun, un petit panda dodu, orphelin après une catastrophe, qui rêve de devenir un grand athlète. Mais ce n’est pas juste une jolie fable animalière. C’est une aventure initiatique où l’on parle de persévérance, d’amitié, et de rêves.
Ce spectacle est le fruit d’une collaboration entre artistes français, chinois, italiens et suisses, porté par une troupe de 15 artistes venus de Chine… et 15 artistes sur scène à Avignon, c’est assez rare pour être souligné.
Je m’appelle Ah Dun est surtout un très beau mélange de marionnettes, théâtre d’objet, ombres chinoises et arts martiaux, qui s’inspire de l’opéra traditionnel chinois et des rituels sacrés.
Les quelques dialogues sont en mandarin (surtitrés bien sûr), mais il n’y a aucune obligation de comprendre la langue ou de savoir lire pour apprécier la beauté du spectacle.
Tout passe par les corps, les gestes, les musiques, les regards.
Et franchement, ça fonctionne. Il y avait des enfants dans la salle, et ils ont adoré, sans que les parents n’aient besoin de leur faire la traduction.
C’est poétique, tendre, joyeux et coloré… un vrai bijou !
Un spectacle qui parle autant aux enfants qu’aux adultes.
On sent le travail minutieux derrière chaque scène, et quel bonheur de pouvoir découvrir des esthétiques et des symboliques différentes.Et puis, il y a cette petite joie simple de voir ce panda nous donner le sourire & l’envie d’aller au bout de nos rêves.
Un spectacle tendre, plein de belles fantaisies, qui embarque tout simplement le public avec une histoire universelle qui fait du bien.
Y’a des spectacles qui font réfléchir, d’autres qui font rire… et puis y’en a, plus rares, qui font les deux en même temps.
Le problème Lapin – cartographie 07, c’est exactement ça.
Ce n’est pas vraiment une pièce de théâtre, c’est plutôt une conférence théâtralisée – mais surtout une conférence complètement dingue… ou plutôt très sérieuse, mais écrite avec une bonne dose de folie douce !
Si vous avez toujours voulu tout savoir sur le lapin qui construit ses terriers dans nos champs, vous êtes au bon endroit. Et si vous ne vous êtes jamais vraiment posé de question sur ce petit mammifère … allez-y quand même, vous serez surpris de découvrir à quel point le lapin peut avoir une place particulière dans notre monde.
Oui, le lapin européen, celui qu’on croit connaître, tout mignon, qu’on retrouve en doudou ou dans nos dessins animés préférés… avec son petit museau qui frétille et sa jolie queue en pompon.
On découvre que le lapin est lié aux mathématiques, à l’art, à la géopolitique même… jusqu’à la sauvegarde des îles Kerguelen.
Et ce n’est pas juste expliqué pour nous faire rire : tout ce qui est dit dans ce spectacle est documenté.
Ce qui est génial, c’est qu’en nous apprenant plein de choses, le duo déjanté Frédéric Ferrer & Hélène Schwartz nous fait beaucoup rire.
C’est une manière intelligente et brillante de nous parler d’anthropocène, de dérèglements planétaires, de notre relation entre humains et animaux… et tout ça, en parlant du lapin.
Alors clairement, après avoir vu ce spectacle, impossible de regarder un lapin comme avant. Et c’est tant mieux.Personnellement, j’aimerais que toutes les prochaines conférences où je vais aller soient aussi drôles et bien écrites que Le problème Lapin… On peut toujours rêver.
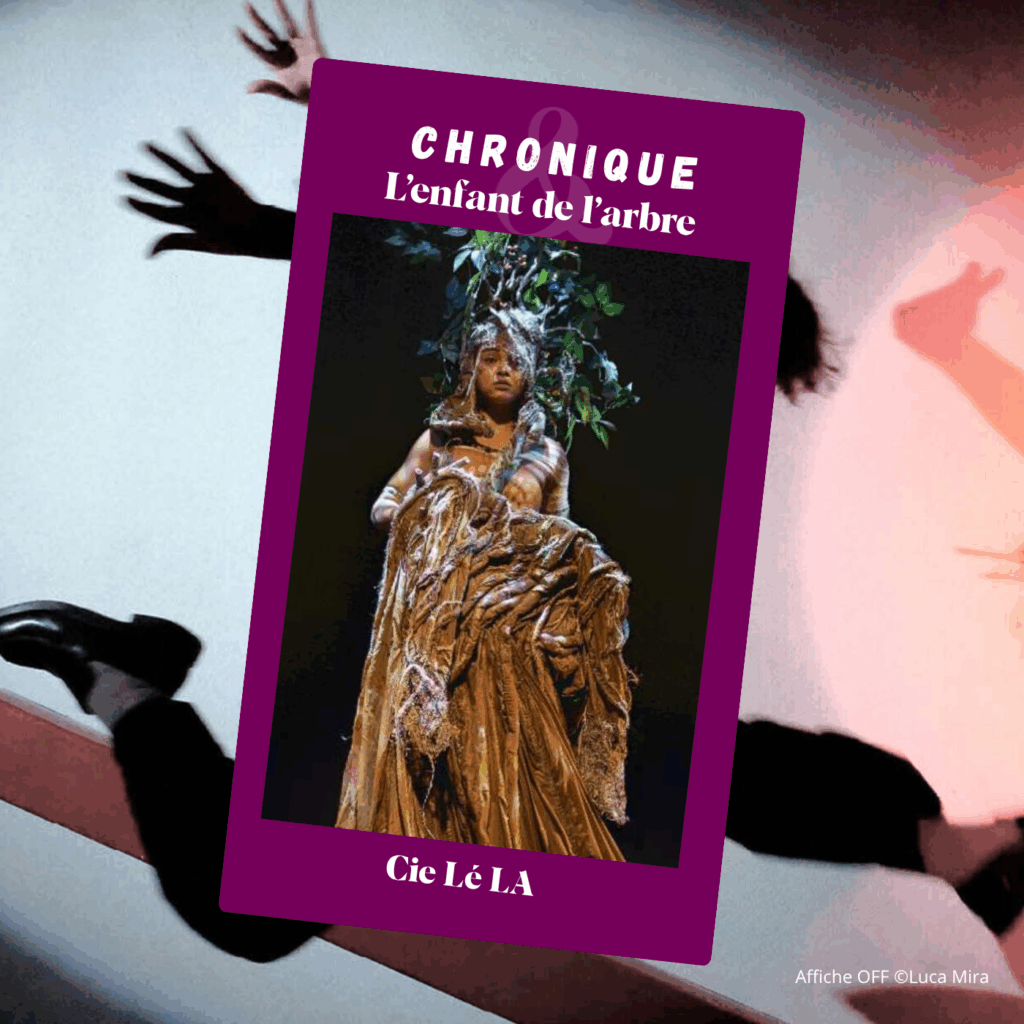
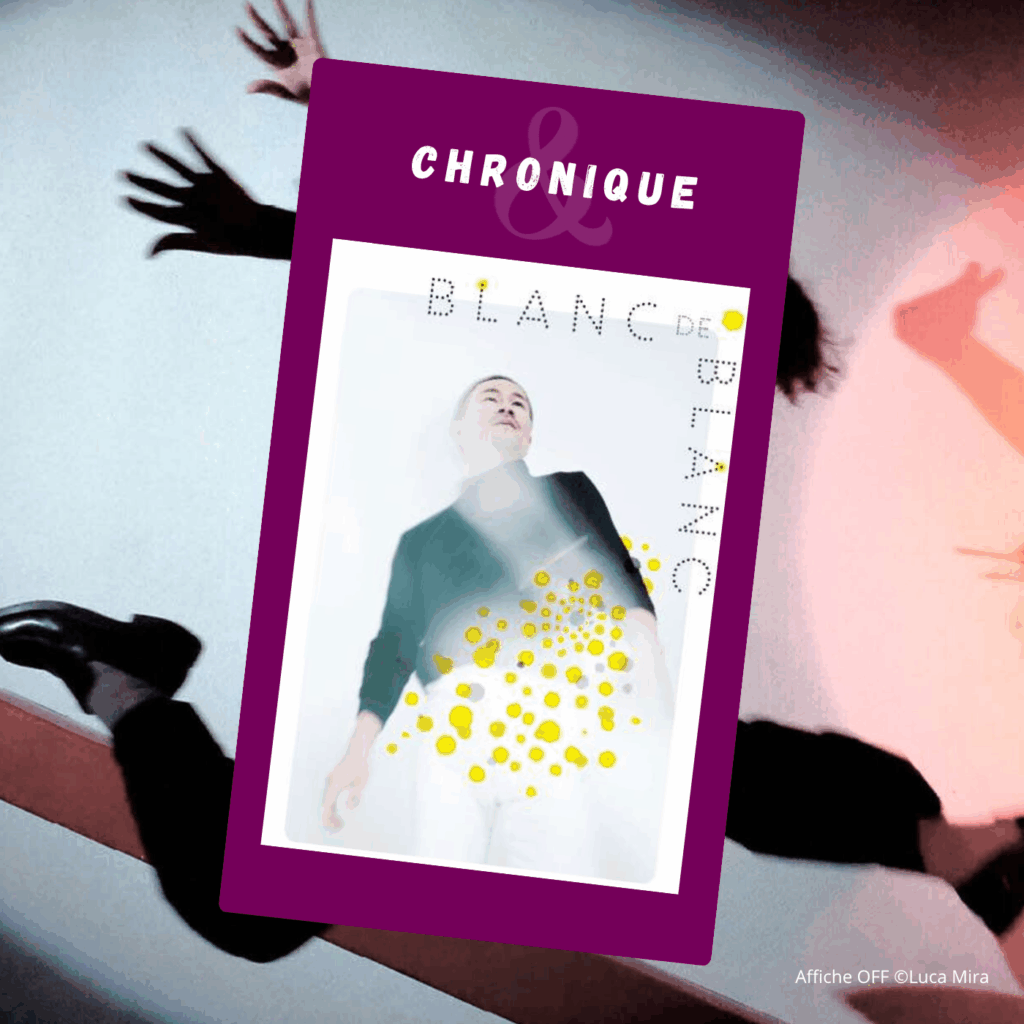
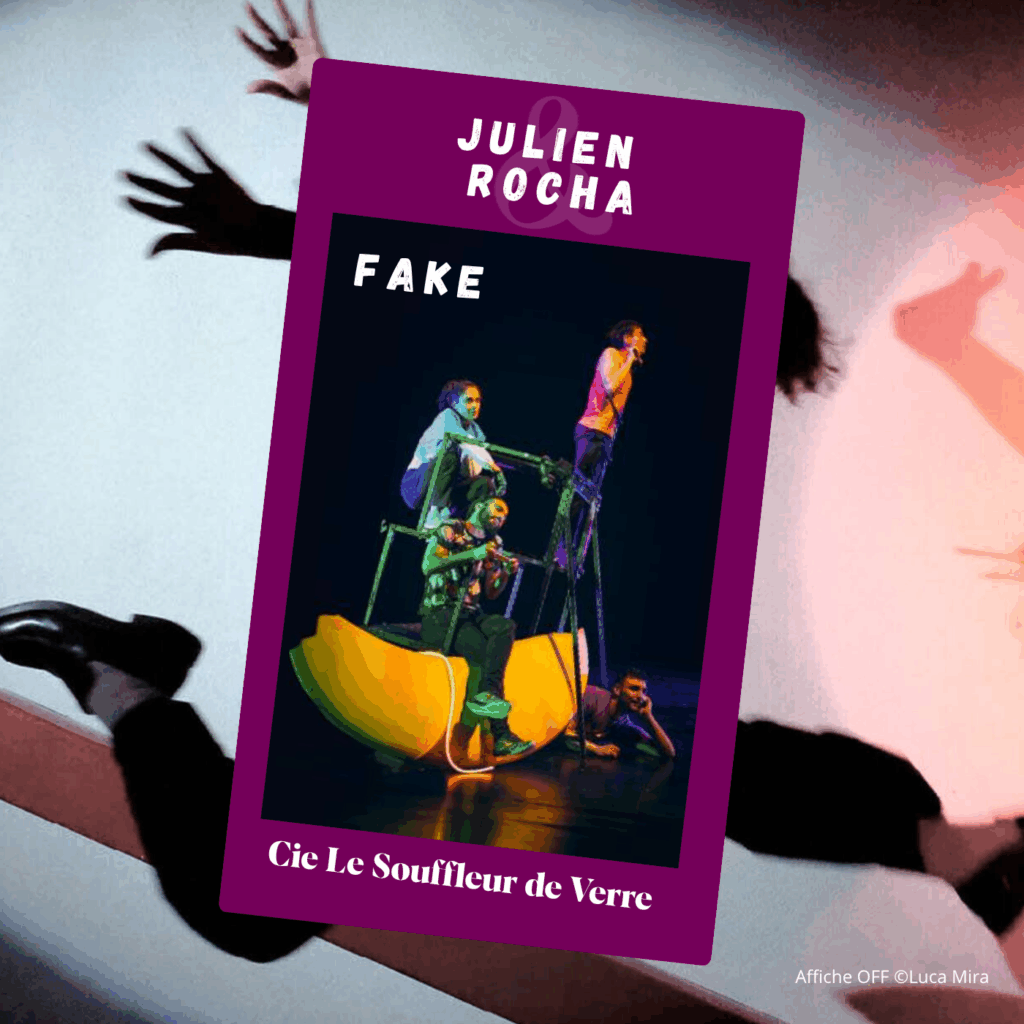
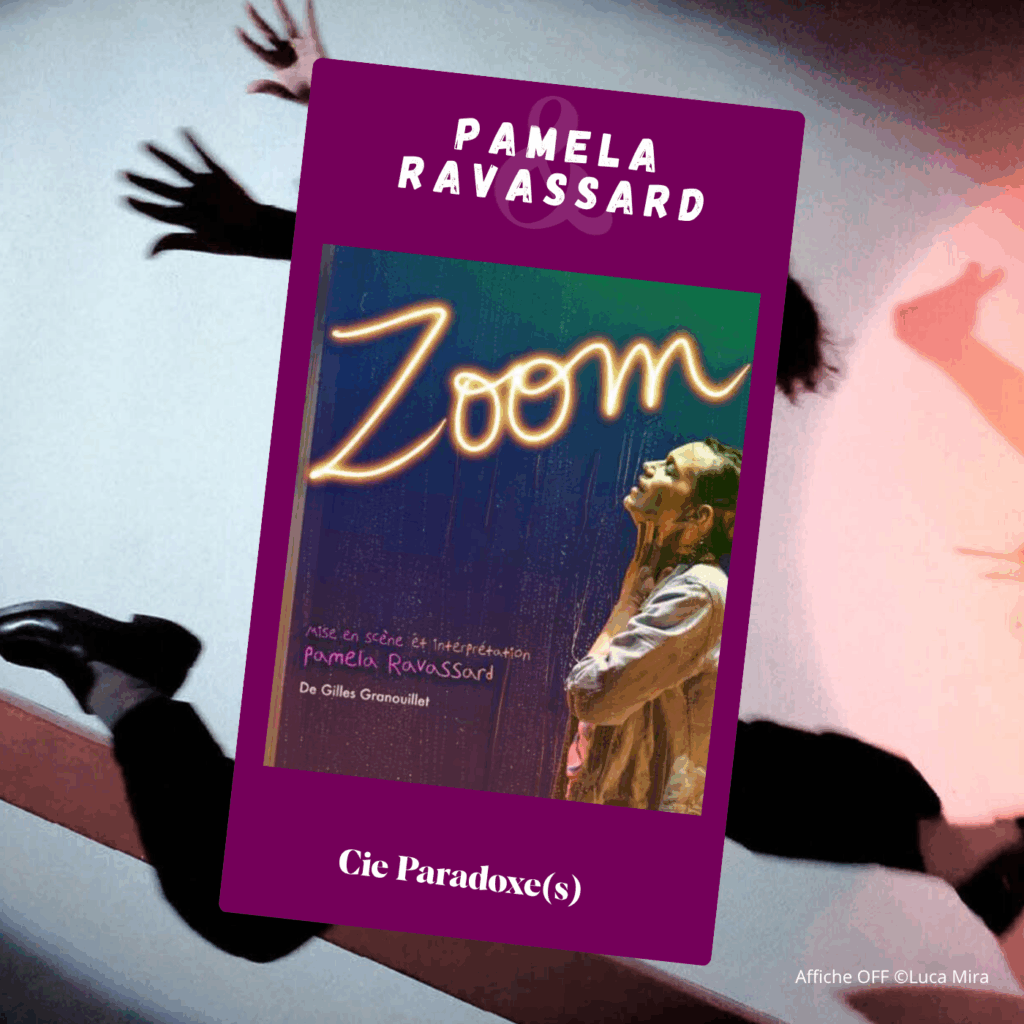
Mon avis sur le spectacle
Ressortir d’une pièce de théâtre avec la chair de poule… c’est ce que j’aime par-dessus tout. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé avec Zoom.
J’avais découvert Paméla Ravassard en tant que metteuse en scène avec Courgette.
Elle revient ici avec un seule en scène, encore une fois une très belle réussite.
Elle y incarne une mère, une femme osédée par la réussite de son enfant, grâce à un texte signé Gilles Granouillet, qui donne une voix à celles qu’on n’écoutent que trop peu, que l’on juge souvent trop vite sans comprendre tout ce qu’il se joue réellement dans leur vie.
Cette mère-là a eu son fils à 17 ans.
Elle est passée de foyers en séries d’entretiens sociaux chez elle, mais elle a une seule idée en tête : que son fils ait une vie meilleure, qu’il ne soit pas, lui aussi, broyé par ce monde.
Burt – son fils – a été conçu dans une salle de cinéma. Et dans l’esprit de sa mère, c’est un signe. Il brillera à Hollywood, c’est son avenir, elle en est sûre.
Sur scène, Pamela Ravassard est seule. Elle incarne tous les personnages. Elle le dit dans le spectacle : “La vie est différente selon l’endroit d’où on la regarde.”
Et ici, on zoom sur le point de vue de cette mère , sans filtre.
On pourrait se dire : encore un seule en scène, encore une actrice qui joue tous les rôles…
Mais non. Là, ça fonctionne vraiment, parce qu’on entre dans le flot intérieur de cette femme, on ressent son urgence, ses détresses, sa force, son amour à la fois immense et désespéré pour son fils.
Et ce qui rend le tout encore plus fort, c’est que la mise en scène, les lumières, les musiques, la scénographie, tout est pensé avec une grande finesse. Dès les premières minutes où l’on entre dans la salle, le contact se crée avec cette femme sans qu’on s’en rende compte et pendant 1h20, voire après le spectacle, ce contact presque intime ne nous lâche plus..
Est-ce qu’une pièce de théâtre peut nous faire regarder le m onde avec un peu plus de coeur et de sensibilité ? J’en suis certaine.
Est-ce que Zoom peut provoquer cet effet chez ses spectateurs et spectatrices ?
Sans aucun doute.
En écrivant ces mots, plusieurs jours après avoir vu le spectacle, j’ai encore le cœur un peu serré, les yeux un peu brillants, je suis émue et ravie d’avoir assisté à une création sincère, sensible, et profondément vivante d’humanité.
🎭 Fake – La Factory théâtre de l’Oulle – 15h35
Mon avis sur le spectacle
Une pièce menée à un rythme effréné entre Scrolls , slide, like et dérives de notre vie tournée 24h/24 vers les écrans. Body shaming, deep fake, haters , … Ce n’est pas juste un nouveau vocabulaire à apprendre , mais une réalité qui nous est tombée dessus plus vite que nous étions prêts à la recevoir et qui nous impacte tous peu importe notre âge mais surtout les jeunes collégiens et lycéens, public cible de Fake.
A la vitesse de infos drôles, tristes, choquantes, révoltantes qui nous arrivent chaque minute , le spectacle se déroule. On passe d’un sujet à l’autre sans avoir le temps de respirer, les 3 comédiens & la comédienne sautent, grimpent, courent, crient cette vie qui les dépassent souvent.
Sans être moralisateur, Fake nous fait prendre de la hauteur de notre siège de théâtre pour appeler à un peu plus de contact humain, pour appeler à respirer et surtout pour amener au débat.
La mise en scène est originale, les comédiens talentueux, alors on peut se dire : mais je ne viens pas au théâtre pour retrouver ce que je vis chaque jour, et bien je pense que Fake permet de prendre le temps de voir ce qui nous hypnotise au quotidien.
Et c’est peut-être ça, la force de Fake :
nous tendre un miroir, sans nous juger, et nous inviter à reprendre un peu de recul dans ce flux constant où tout va trop vite.Pas pour fuir les écrans, ni pour diaboliser le numérique, mais simplement pour réapprendre à se parler en vrai, à lever les yeux, à questionner ce qu’on lit, ce qu’on partage, ce qu’on croit.
🎭 L’enfant de l’arbre – Chapelle du verbe incarné – 15h05
Mon avis sur le spectacle
Chaque année, même si ce n’est pas ce vers quoi je vais spontanément, je prends toujours le temps d’aller voir au moins un ou deux spectacles jeune public.
Et hier, je suis retournée à la Chapelle du Verbe Incarné, pour découvrir L’enfant de l’arbre. Et… quel bonheur.
Dès le début, comme les enfants autour de moi, j’ai été transportée dans la forêt.
grâce à cet arbre majestueux qui apparaît, presque magique, planté là, au centre de la scène, comme un sage qui à la fois veille sur nous et à cet enfant heureux au pied de son arbre qui nous invite à être témoin de son histoire
L’enfant de l’arbre, c’est une fable poétique, accessible aux plus jeunes mais qui touche aussi les adultes. La preuve avec moi !
Une fable sur notre lien à la nature, à l’eau et sur notre rapport au travail.
L’enfant de l’arbre nous emporte avec lui de manière espiègle, et intelligente pour nous montrer qu’en regardant le monde avec des yeux plus ingénus, en tentant de le comprendre sous un autre angle, on peut se rendre compte de l’absurdité de nos comportements.
Les yeux de l’enfant, nous permettent ce regard sur les éléments plus sensibles, nous permettent de retrouver cette légèreté que nous avons oubliée, et ce rapport à la nature simple et équilibré.
Je crois qu’il est vraiment temps de renouer avec notre âme d’enfant et d’aller voir ce spectacle pour nous reconnecter au vivant.
🎭 Blanc de Blanc – Golovine – 14h00
Mon avis sur le spectacle
Parfois, il ne faut pas grand-chose.
Un corps.
Une lumière.
Et quelques notes de musique, voire le silence.
Blanc de Blanc, c’est tout ça à la fois. Et c’est justement ce “presque rien” qui m’a enveloppée pendant toute la durée du spectacle.
Sur scène, Shu Okuno, seul, nous offre une parenthèse.Le spectacle est présenté au Théâtre Golovine, ce lieu avignonnais dédié à la danse. Et cette parenthèse…c’est une forme de danse — ou peut-être pas. Mais peu importe.
C’est en tout cas du mouvement, de la précision, du souffle qu’il partage avec nous.
Quelque chose de subtil, de silencieux, mais très présent. Il y a un peu de musique. Pas de parole. Pas de narration évidente. Et pourtant… il se passe quelque chose.
Pendant un moment, je me suis laissée dériver.
Et ce que j’ai gardé, c’est cette sensation rare : de la douceur, du calme, du temps suspendu.
Et franchement, au milieu de l’agitation du Off, ça fait un bien fou.
Si je devais vous dire de quoi parle Blanc de Blanc, je crois que je dirais simplement que Shu Okuno raconte son histoire.
Mais que vous, vous y verrez peut-être autre chose.
C’est ce genre de spectacle où chacun·e projette ses propres images. Et où parfois, un silence ou une pause en dit bien plus long qu’un mouvement.
J’ai été touchée par la précision de chaque geste, son énergie solaire qui dégage de son regard, et la sérénité d’une prestation qui demande pourtant beaucoup de précision.
J’ai tout aimé. Et je suis sortie ressourcée.
Alors oui, si vous êtes hyperactif·ve, que vous avez besoin d’action, de rythme, de rebondissements… ce n’est peut-être pas pour vous.
Mais si vous cherchez une bulle blanche, toute douce, pour respirer avant de replonger dans le tumulte de la vie, alors Blanc de Blanc est un petit bijou à ne pas manquer.
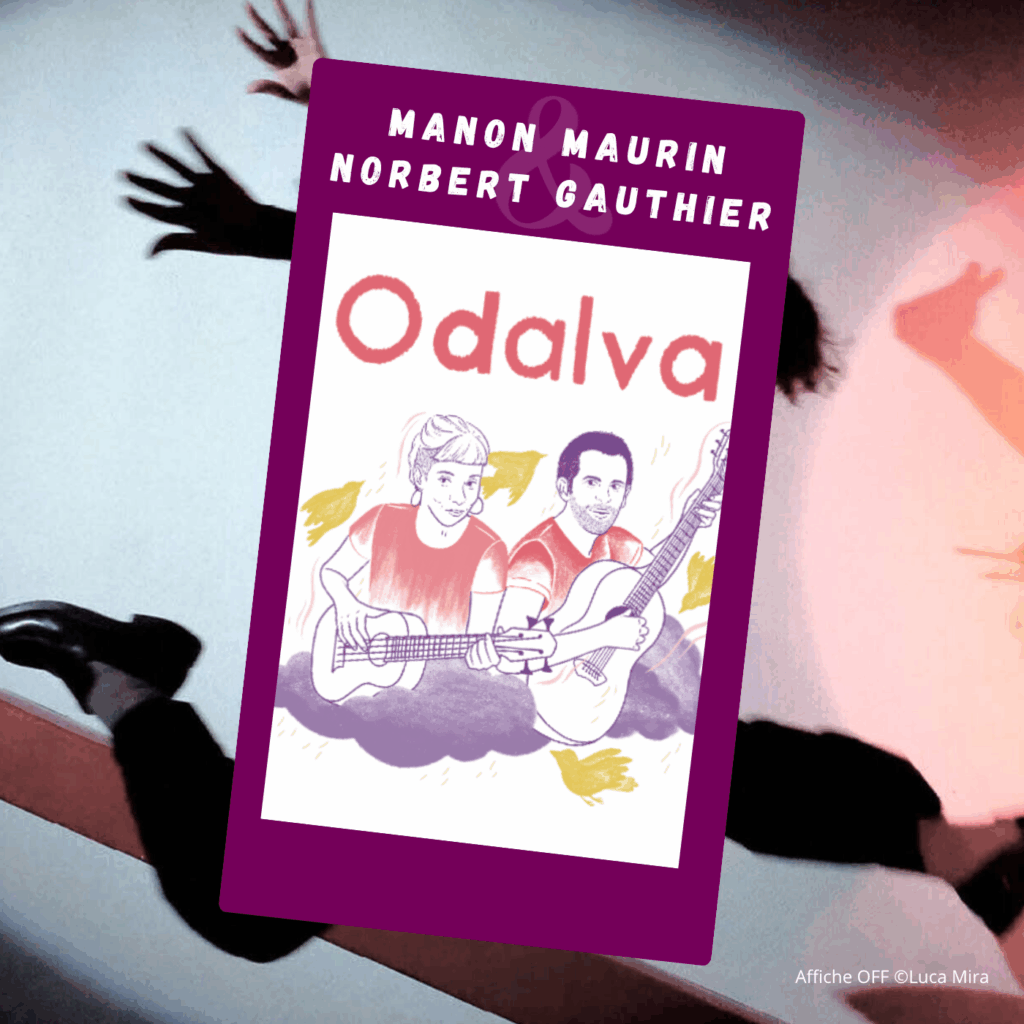
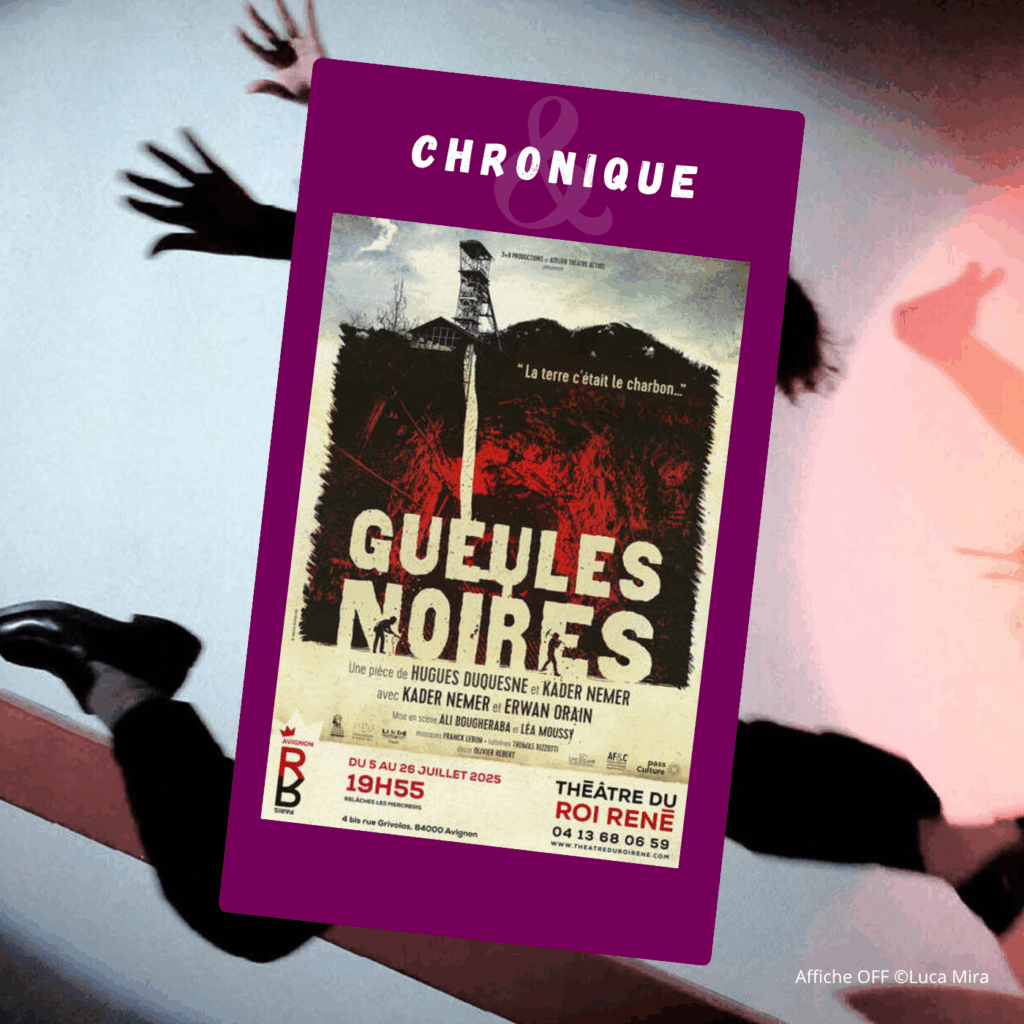
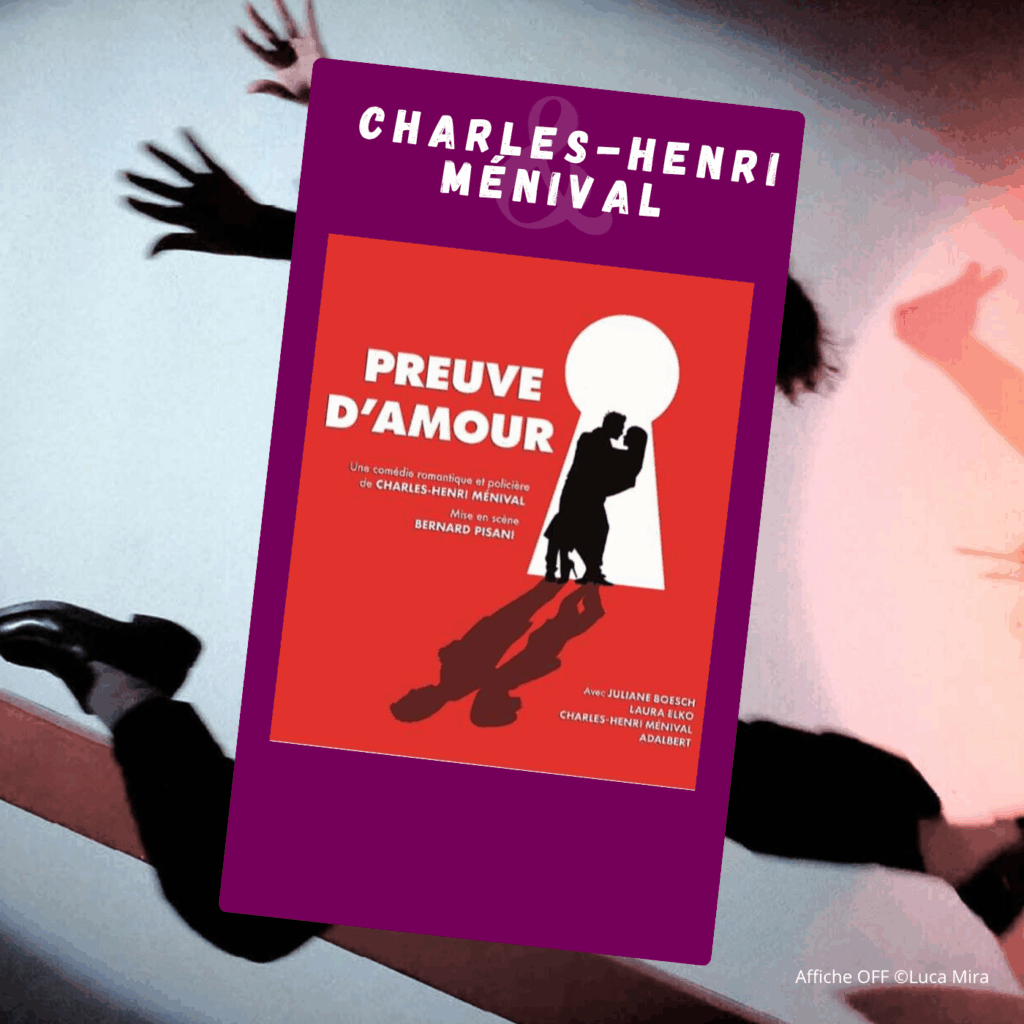
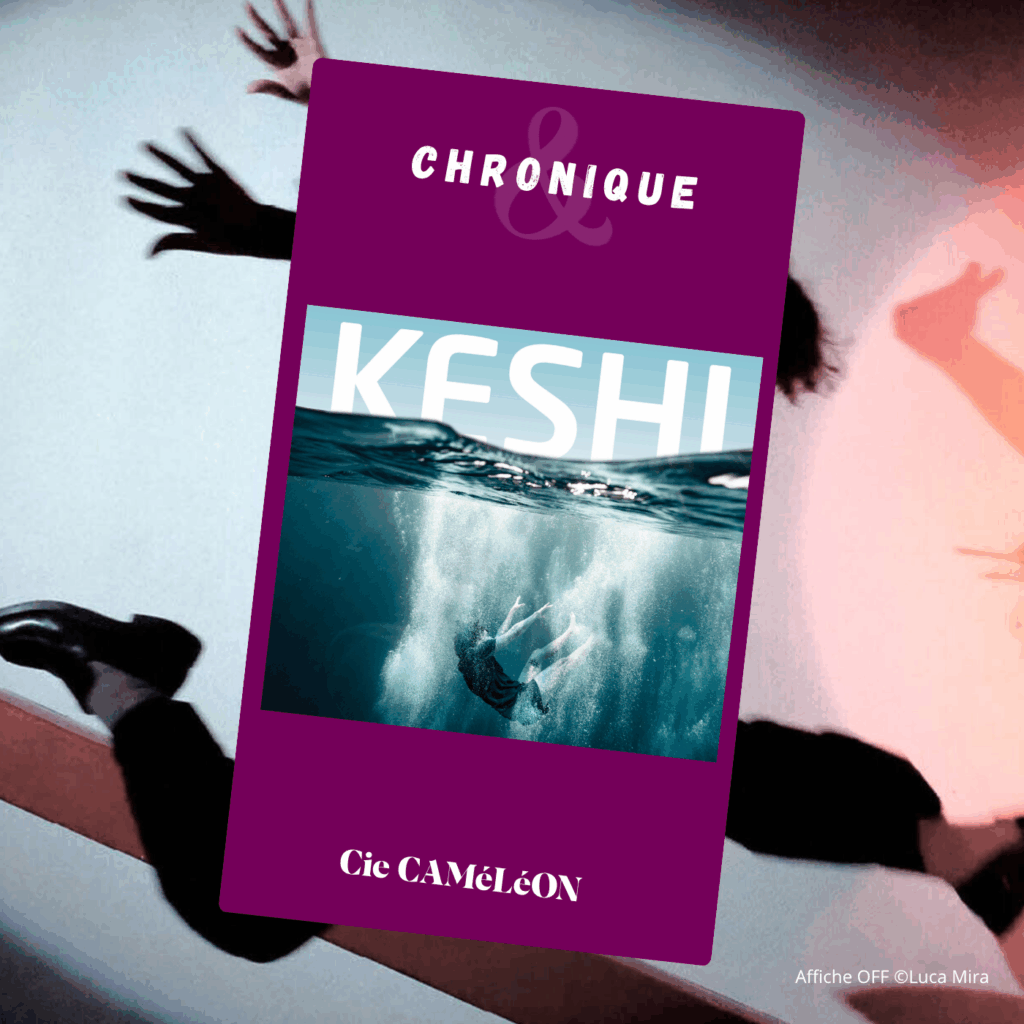
🎭La pochette surprise est à ouvrir à 19h45 à l’Atipik théâtre – relâche les 8, 15, 22 juillet
Mon avis sur le spectacle
Cette année en me baladant dans les rues d’Avignon, je vois de moins en moins de compagnies qui paradent et pourtant cela fait partie de mes plaisirs du Festival d’Avignon : entendre des petits extraits de spectacles, rire ou s’émouvoir au détour d’une rue et découvrir des pépites inattendues.
Et c’est ce qui s’est passé en tout début de Festival quand j’ai entendu la douce musique et les voix du groupe Odalva.
Ce jour-là j’attendais une amie devant un café et la belle voix de Manon accompagnée de la guitare de Norbert ont attiré mon attention. Un pur bonheur que j’ai voulu prolonger en allant les voir en spectacle et ce fut un vrai beau moment des chansons engagées, chantées avec douceur par les deux membres du groupe, avec une petite touche de folie entre chaque chanson tout en poésie qui apporte un réel plus à leur spectacle et surtout une belle complicité qui passe à la fois entre les deux artistes mais également avec le public….L’avantage d’être dans une toute salle !
Ils écrivent et composent leurs chansons, militent depuis plus longtemps pour aider à la culture et la rencontre avec les plus démunis et petit atout supplémentaire, le duo est vauclusien.
J’ai beaucoup aimé leur sincérité cette sensation de s’être offert une bulle délicate bien ancrée dans notre monde mais avec une touche sucrée qui donne l’impression de le voir avec un peu plus de couleurs et de se sentir vivante.
Sa reco au OFF :
Chevaleresse au théâtre des Carmes à 10h00
🎭 Preuve d’amour – Théâtre Notre Dame – 14h00
Résumé de l’interview
Charles-Henri Ménival, je suis auteur de théâtre et aussi comédien, producteur de la pièce et accessoirement gérant de la librairie théâtrale à Paris, qui est une maison d’édition et une librairie spécialisée en théâtre.
Preuve d’amour, j’ai écrit le spectacle, je joue dedans avec deux comédiennes et une marionnette, donc Juliane Bosch, Laura Elko et Adalbert. Et c’est une mise en scène signée Bernard Pizani.
J’appelle ça une comédie romantique et policière, parce que c’est un mélange de vaudeville et de thriller psychologique. On va suivre l’histoire d’un psy qui perd une bague la veille de son mariage, et ce tout petit objet va provoquer une cascade de situations assez inextricables.
Mon défi d’écriture, c’était justement d’essayer de partir d’un tout petit détail qui prend une importance dramatique. C’est un procédé de dramatisation, comme on peut le voir chez Yasmina Reza par exemple. Donc on est un peu dans ce type de pièce, mais on va aussi retrouver tous les ingrédients d’un certain théâtre de boulevard, même si c’est évidemment plus contemporain que ça.
C’est une comédie intelligente dans le sens où, même si c’est constamment léger et constamment drôle, il y a quand même une subtilité, des petits messages, des petites références culturelles.
C’est un événement qui m’est réellement arrivé personnellement. Il se trouve que moi aussi j’ai perdu un bijou qu’on m’avait offert, qui était très important pour moi. Je l’ai perdu d’une façon assez inexplicable, et surtout c’est la façon dont je l’ai retrouvé qui était assez bizarre…
J’étais aussi parti de contraintes. Ma première pièce avait sept personnages, et on m’avait dit : “Tu ne trouveras jamais de producteur à sept personnages.” Et effectivement, je n’en ai pas trouvé un seul. Donc il y a cette contrainte aujourd’hui, dans le théâtre privé parisien, d’écrire pour maximum trois ou quatre personnages.
Et c’est plus difficile d’écrire pour trois que pour sept, parce que quand on est à court d’idées, on peut faire entrer un nouveau personnage, et ça redynamise. Là, il faut vraiment nourrir les personnages, leur donner une histoire, une profondeur.
Ces personnages sont nourris de mon expérience personnelle. Le psy Maxime, c’est un psychanalyste freudien ; Mathilde, une jeune femme très forte, très insubmersible ; Juliette, sa sœur, beaucoup plus rêveuse, émotive, la femme-enfant. Et il y a Monsieur Morse, la peluche de Juliette, qui parle pour elle.
C’est une jeune femme que j’ai réellement fréquentée qui avait une peluche à qui elle faisait dire toutes les vacheries possibles.
Laura a postulé en disant : “Je suis ventriloque.” Elle a auditionné avec Adalbert, sa marionnette, et on a tout de suite accroché. On dit pour la blague qu’on a d’abord casté Adalbert, et qu’on a pris Laura aussi.
Finalement, Adalbert a aussi une personnalité bien à lui. C’est lui qui joue. C’est aussi pour ça qu’on a mis son nom sur l’affiche.
🎭Gueules Noires – Roi René à 19h55 -Relâche les mercredis
Mon avis sur le spectacle
C’est un retour sur mon territoire d’origine, mon territoire de cœur : le Nord.
Et pas n’importe où : au fin fond d’une mine de charbon.
Avec ce spectacle, le public se retrouve à plus de 300 mètres sous terre, dans la fosse n°7 de Liévin, en 1965.
Un coup de grisou vient de se produire.
21 mineurs sont morts.
Mais cette pièce nous emmène ailleurs.
Elle invente une histoire dans l’Histoire : celle de deux survivants coincés dans une poche d’air, Ahmed, mineur d’origine algérienne, et Stéphane, porion d’origine polonaise.
Deux hommes que tout semble opposer : l’origine, le statut, la culture, la manière de vivre.
Mais au fond du fond… quand il n’y a plus que le silence, le noir, l’attente… il ne reste que l’humanité.
Ce spectacle, dont le texte a été écrit par Kader Nemer et Hugues Duquesne est porté par l’interprétation très juste et sensible de Kader et Erwan Orain.
Ils nous embarquent dans cette histoire sous tension, qui rendrait presque claustrophobique par moments mais surtout remplie d’humanité.
Le message est clair :
Pourquoi faut-il attendre une catastrophe pour enfin rencontrer l’autre ?
Pourquoi faut-il être pris au piège pour que les frontières tombent ?
Moi, ch’tie d’origine, ce que j’ai vu dans cette pièce…
je le connaissais déjà.
Je l’ai entendue dans les récits familiaux, dans les mémoires collectives, mais ça ne m’a pas empêchée d’être touchée.
Parce que Gueules Noires, ce n’est pas juste un spectacle historique, c’est une histoire de fraternité entre deux être humains.
Et puis, il faut parler du décor : une scénographie bluffante, qui nous plonge littéralement sous terre. On sent la roche, l’humidité, l’oppression…
Et malgré ça, il y a beaucoup de lumière dans ce spectacle fort, engagé, nécessaire.
Mon avis sur le spectacle
J’aime aller au théâtre le matin, débuter la journée avec une histoire que l’on ne connaît pas, sans trop savoir où elle va nous emmener. Et bien ce matin-là je suis partie à Tahiti grâce à la pièce : Keshi, la nouvelle création de la Compagnie Caméléon, venue de Polynésie française.
C’est une compagnie que je suis depuis plusieurs années et que j’admire particulièrement pour sa capacité à mêler histoires fortes, intimes, avec une petite touche de fantastique, qui nous pousse à regarder le réel autrement.
En 2018, je les avais découverts et j’ai eu mon premier coup de cœur avec Les Champignons de Paris. Et là, avec Keshi, ils signent à nouveau une création puissante & profonde.
Keshi, c’est le nom qu’on donne à une perle irrégulière, pas vraiment désirée, pas parfaite non plus.
Mais justement, c’est ça qui fait sa beauté.
Ce sont des perles organiques, sans noyau, façonnées par le vivant, par l’inattendu, et cette métaphore, elle porte tout le spectacle.
Sur scène, on suit un jeune homme, prisonnier d’un silence familial qui l’empêche de se construire.
Il est question d’un père qu’on ne connaît pas, de générations qui se taisent et d’un besoin viscéral de vérité pour pouvoir avancer.
Ce spectacle parle de construction identitaire, de masculinité, et du poids du silence qui peut tout détruire.
La force de cette création, c’est qu’elle s’ancre dans une réalité très concrète : pour écrire Keshi, la compagnie a mené des ateliers d’écriture en prison à Tahiti, et aussi avec des jeunes suivis par la PJJ. À partir de leurs récits, Solenn Denis, l’autrice, a composé une fiction mais une fiction nourrie de vécus et ça se sent dans le spectacle
Comme les Champignons de Paris, ce n’est pas un spectacle où l’on ressort avec un avis franc et massif, c’est plutôt un spectacle qu’il faut laisser infuser. On sort en sachant qu’il va laisser un marque dans notre esprit, une petite lumière venue de l’autre bout de la planète.
Je vous conseille vraiment d’aller voir Guillaume Gay, Tuarii Tracqui, Tepa Teuru, accompagnés cette fois de Justine Moulinier Parce que leur jeu est juste, sensible et puissant. Parce que la scénographie et les costumes nous plongent dans un décors singulier, et parce qu’au fond, ce spectacle nous incite toutes et tous à sortir du silence pour faire naître ce qui fait de nous une perle précieuse mais si elle est imparfaite.
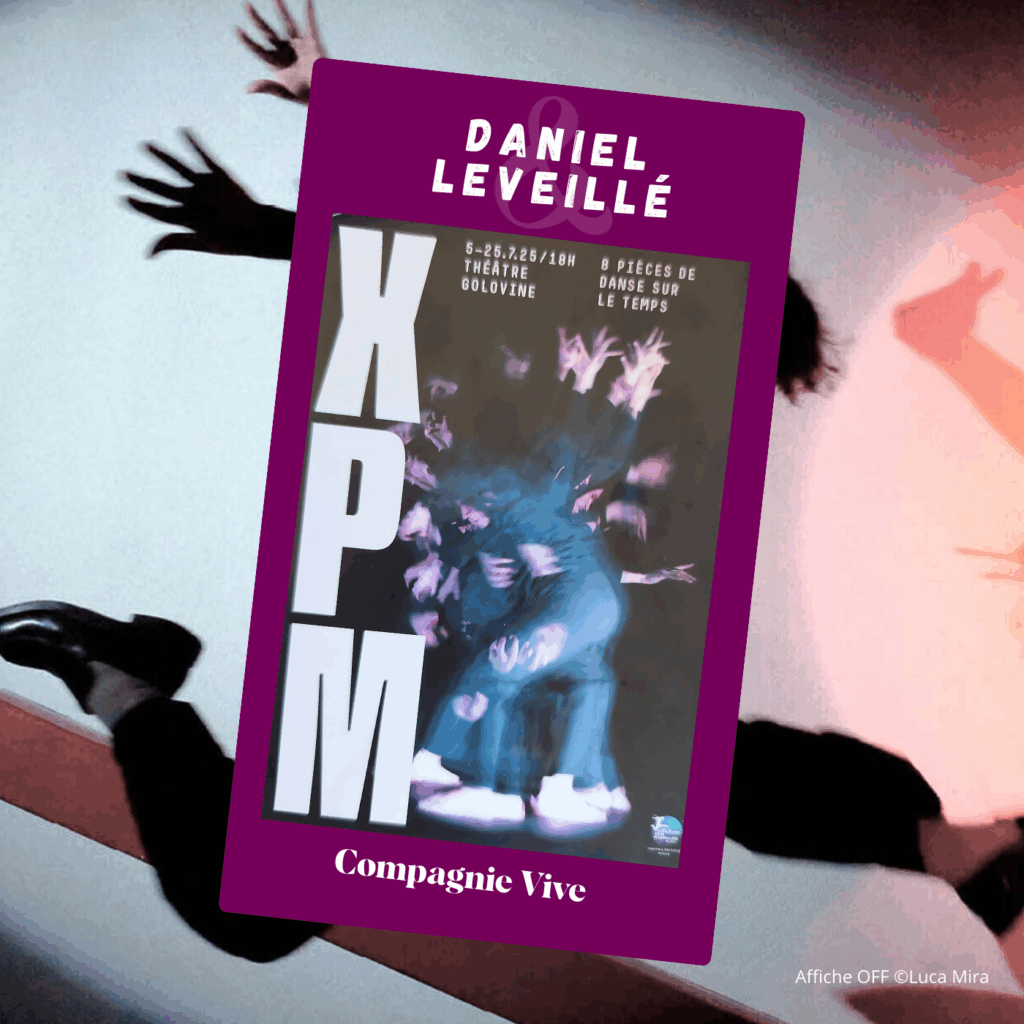
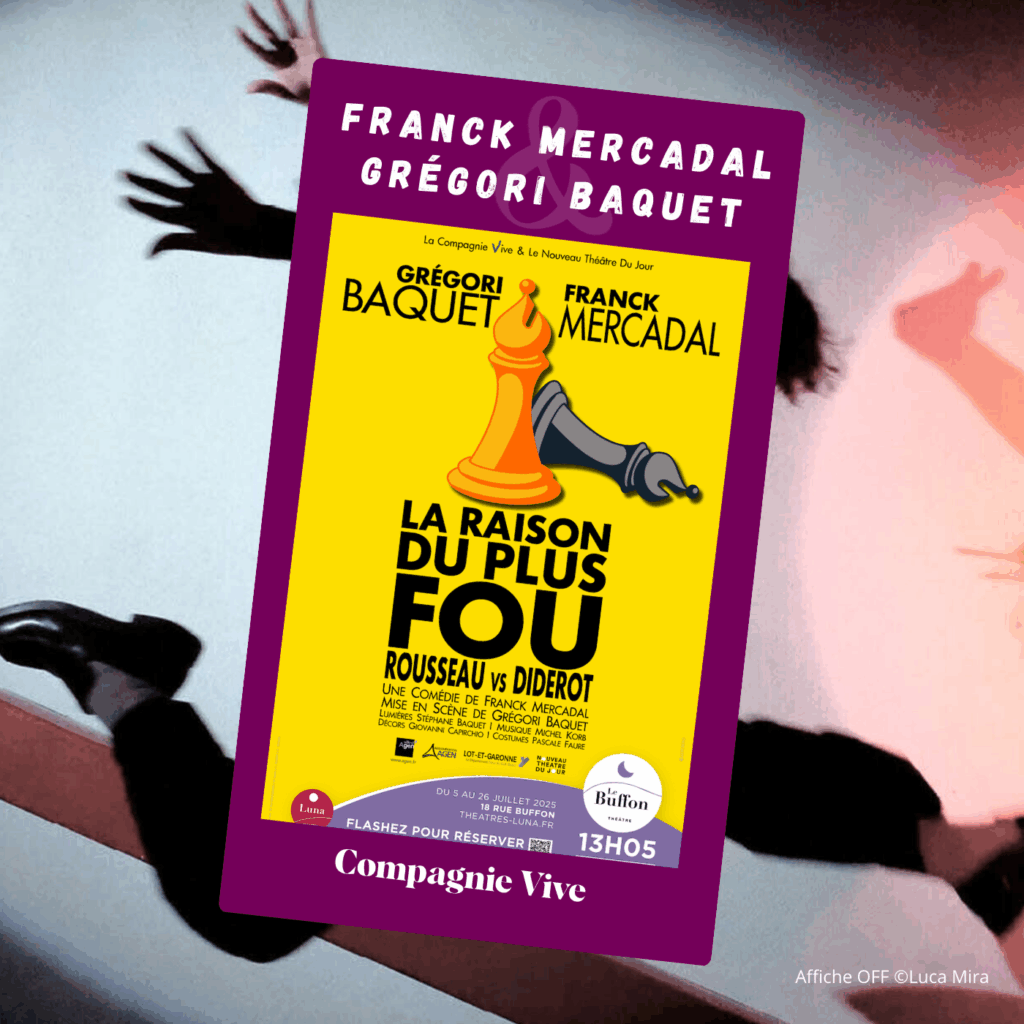
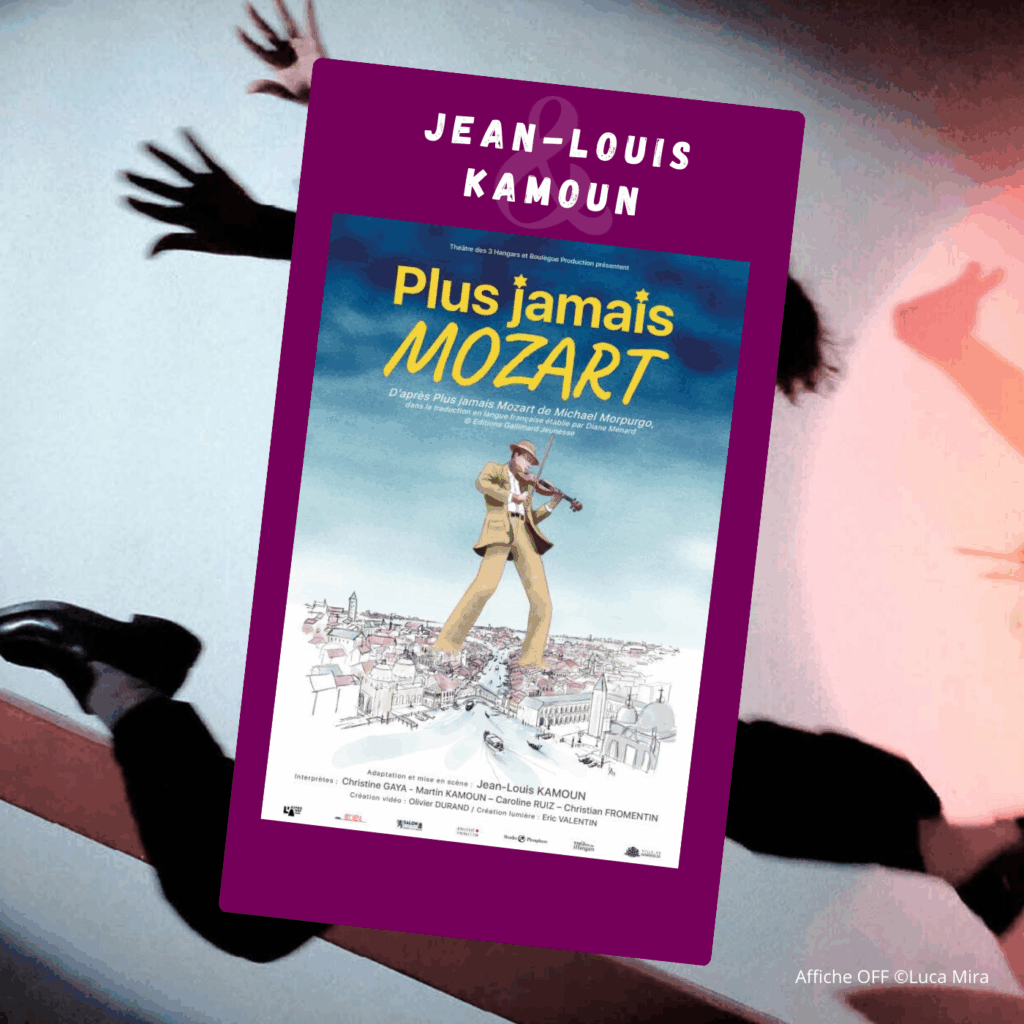
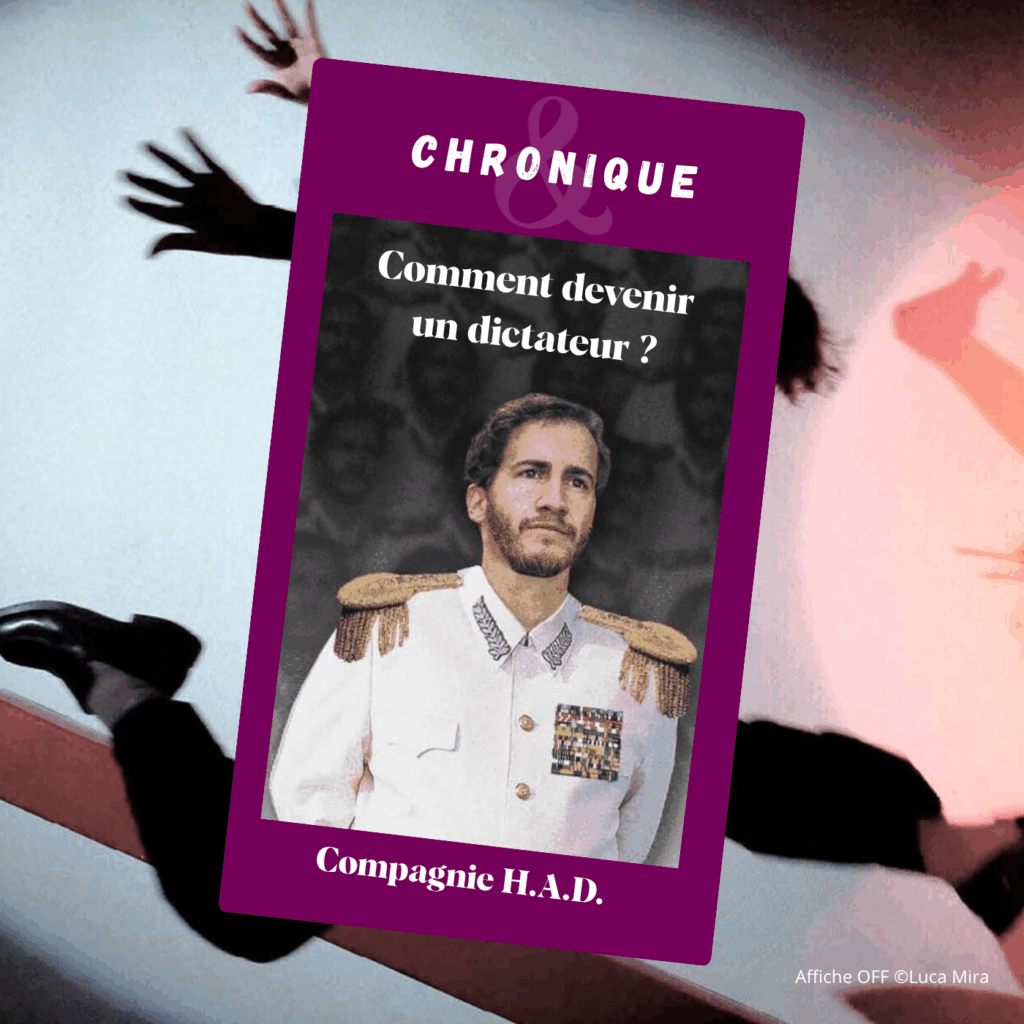
🎭RDV au Golovine à 18h – Relâche les 7, 14, 21 juillet
Mon avis sur le spectacle
Énorme coup de cœur pour ce spectacle de danse emmené avec une telle énergie par Daniel Léveillé et Daniel Borak Ils volent sur scène, explorent les mouvements et les rythmes, nous embarquent dans une série de tableaux autour de notre rapport au temps.
Les rythmes de leurs pieds supportent les mouvements de leur corps entre danse contemporaine, hip hop, danse classique et claquettes bien sûr, mais des claquettes comme on ne les voit que trop rarement.
La scénographie, les lumières créent une ambiance intimiste qui nous amènent à l’introspection, a la connexion avec les artistes.
Certains des tableaux sont menés à un rythme effréné à tel point que j’étais en apnée pour essayer de capter chaque mouvement et chaque rythme.
C’est finement chorégraphié et écrit , dansé avec une telle énergie positive communicative. J’avais envie de me lever entre chaque tableau pour applaudir , je crois que je n’étais pas la seule.
Je suis ressortie en tapant des pieds avec l’envie de prendre le temps de capter le rythme de mon cœur, le rythme de mes pas, le rythme des gens autour de moi.
Je crois que j’y retournerai car il y a sûrement plein de détails que je n’ai pas capté.
Allez-y vraiment que vous aimiez ou non la danse, que vous aimiez ou non les claquettes, c’est un véritable bijou !!!
Résumé de l’interview de Daniel Leveillé
Qui es-tu, Daniel ?
Je suis danseur, basé à Genève. J’ai une formation en classique, contemporain, jazz… mais je me spécialise en claquettes. Avec Daniel Borak, mon complice, on a créé la compagnie et le spectacle XPM autour de notre langage commun : la danse percussive.
C’est quoi, XPM ?
Un spectacle en huit pièces, autour du thème du temps. Chaque tableau propose une vision différente : le temps biologique, le temps du souvenir, le temps qui passe… C’est une forme chorégraphique qui invite à ressentir cette question universelle de notre rapport au temps.
Comment avez-vous construit le spectacle ?
On travaille à deux, parfois en solo. On commence par le rythme, on explore, on dialogue en mouvement, et on construit autour.
Il y a de l’impro sur scène ?
Oui ! Même si tout paraît très précis, on garde des espaces d’improvisation chaque soir. Et pour que le plaisir reste intact, on se lance des petits défis secrets : insérer un pas tiré au sort, une variation, une référence… Ça garde l’étincelle vivante.
Pourquoi les claquettes ?
C’est une danse peu codifiée, très riche rythmiquement. Elle vient d’une culture populaire, transmise oralement, avec un grand potentiel créatif. Mais on veut s’éloigner de l’image Fred Astaire et comédies musicales. Nos claquettes sont contemporaines, actuelles, mélangées à du hip-hop, du classique… On veut les montrer comme un langage chorégraphique d’aujourd’hui.
Ce spectacle au Festival, c’est une première ?
Pour Daniel Borak, oui. Moi, c’est mon troisième Avignon. Mais c’est la première fois qu’on vient avec un projet à nous. On a développé notre petite routine au fil des jours entre parade dans les rues d’Avignon et spectacle en fin d’après-midi, toujours claquettes aux pieds.
Sa reco au OFF :
Swingum au 3S -10th avenue, par des danseurs suisses amis. Une histoire vraie autour de la Seconde Guerre mondiale, du swing, des retrouvailles… C’est tendre, drôle, et familial.
🎭 RDV à 13h05 au Buffon – relâche les 10, 21 juillet
Mon avis sur le spectacle
Deuxième gros coup de cœur de l’année avec ce duo entre Franck Mercadal et Gregori Baquet. Et oui je vous invite à participer à une rencontre entre Diderot et Rousseau !
Mais La raison du plus fou c’est bien plus qu’une discussion entre deux personnages historiques, c’est bien plus qu’une pièce de théâtre avec des costumes d’époque, c’est bien plus qu’une partie d’échecs endiablée entre deux amis- ennemis, c’est un spectacle rythmé et drôle. Et surtout c’est surprenant, mais je ne peux pas vous en dire plus. Seules les spectateurs savent de quoi je parle.
Un duel verbal et physique entre les deux acteurs à la belle complicité. Ils sont espiègles et stratèges et nous embarquent autant par le texte, leur jeu d’acteurs que la mise en scène.
Tout ce que j’aime dans le théâtre , un théâtre où l’on apprend, un théâtre où l’on interroge notre rapport aux autres, et un théâtre accessible à tous, où l’on est surpris et où bien sûr on se divertit.
Un grand bravo à tous les deux pour ce moment d’intelligence joyeuse, qui rappelle que débattre peut être un jeu, un duel, un plaisir.
On en ressort le sourire en coin, l’esprit en éveil… et l’envie de rejouer la partie.
Retranscription de l’interview de Franck Mercadal & Gregori Baquet
Franck : Ça s’appelle La raison du plus fou, c’est une pièce sur une rencontre entre Diderot et Rousseau autour d’une partie d’échecs. Je suis l’auteur de la pièce. Je voulais écrire une histoire autour d’une relation d’amitié qui se développe mal, on va dire, une relation d’amitié déçue, des gens qui ont refait le monde à 20 ans à un comptoir de bar, en l’occurrence eux c’était le Procope à Paris, et qui plus de 20 ans après sont devenus ennemis, et se retrouvent une dernière fois. Pourquoi ? Parce que Rousseau écrit ses Confessions, et il en fait des lectures privées, à Paris, et il critique beaucoup Diderot, et notamment son encyclopédie, et Diderot, qui a été plusieurs fois censuré par le pouvoir royal, craint que Rousseau, qui est très célèbre et qui a écrit pour l’Encyclopédie, puisse nuire à l’apparition des derniers tomes de l’encyclopédie.
Grégori : Donc Diderot va piéger Rousseau en lui proposant une partie d’échecs, en lui disant, ben voilà, si je gagne, vous arrêtez les Confessions, et si je perds, je vous aide à continuer, grosso modo.
Franck : C’est un duel, c’est un pacte, et puis à l’issue de la partie d’échecs, l’un décidera du sort de l’autre.
Marie-Cécile : Qui sont Rousseau et Diderot ?
Franck : Alors Rousseau, c’est l’auteur d’un livre qui encore aujourd’hui fait référence Le Contrat social. Il a écrit aussi à l’époque un roman qui s’appelle Nouvelle Héloïse, qui a été un peu perdu de vue de nos jours, mais qui a eu un très grand succès, qui a fait de lui un auteur très célèbre au XVIIIe siècle. C’est le penseur de l’homme. C’est le penseur de l’homme. « L’homme est né libre, la société le corrompt ». Alors que Diderot, lui, a écrit du théâtre, et il a contribué à créer l’Encyclopédie. Alors, tout le monde sait ce qu’est une encyclopédie aujourd’hui, mais à l’époque, ça n’existait pas. Donc c’est la première encyclopédie créée au monde par Diderot et associée à d’Alembert. Mais Diderot va continuer pendant 20 ans à mener les travaux de l’Encyclopédie, c’est-à-dire à rechercher les auteurs, à écrire lui-même des articles. D’Alembert va d’ailleurs arrêter au milieu du guet. Et lui continuera jusqu’au bout, pour écrire 28 volumes, 71 000 articles. Alors, il n’est pas le seul à écrire, bien évidemment. Donc il a été associé à beaucoup d’auteurs.
Grégori : Dont Rousseau, d’ailleurs.
Franck : Dont Rousseau, qui avait écrit un article sur la musique. Donc Diderot va devenir le rédacteur en chef de cette Encyclopédie pendant près de 20 ans. Ça va lui donner un travail titanesque, un peu comme celui de mon compère Grégory Baquet, à la direction d’un théâtre, à la mise en scène, entre autres.
Marie-Cécile : Donc il y a ces deux penseurs qu’on connaît. Mais alors, faire une pièce en 2025, sur des penseurs historiques, est-ce qu’on se dit qu’on va réussir à intéresser les spectateurs avec ça ?
Franck : Alors, c’est vrai que Rousseau et Diderot n’ont plus d’actualité aujourd’hui. Quand Rousseau dit que le plus dangereux, c’est l’ingérence des intérêts privés dans les affaires publiques, on sait bien que ça n’a plus d’actualité. Quand Diderot dit que le problème avec la morale, c’est que c’est toujours la morale des autres, on sait bien que ça n’a plus d’actualité.
Grégori : On a grandi par rapport à ça, bien évidemment.
Franck : Donc peut-être que ces auteurs, leurs citations, peuvent avoir actualité aujourd’hui. Avec Greg, nous avons voulu montrer un spectacle qui puisse être d’actualité, avec plein de surprises. On s’attend effectivement à un duel, à fleuret moucheté autour d’une partie d’échecs. Ce n’est pas tout à fait ça. Alors, je ne vais pas vous révéler tout, parce que tout aussi repose sur les effets de surprises que vous trouverez tout au long de la pièce. Mais c’est une pièce qu’on a voulu aussi décalée, humoristique, comme je vous le disais, avec des rapports avec l’actualité. Et puis aussi qui peut être touchante, parce que c’est des personnes comme toute forte relation d’amitié qui s’appréciaient beaucoup et qui ont pu aussi avoir des moments de crise.
Marie-Cécile : Alors, une fois que toi, tu as eu le texte, Grégori, comment tu as travaillé la mise en scène de ce spectacle ?
Grégori : Alors, ça s’est fait d’une manière un peu particulière, puisque Franck m’a envoyé le texte au départ pour que je joue avec lui. Et il voulait que, comme on fait, beaucoup entre comédiens, on s’envoie des textes. Et puis, on se dit, on ira chercher un metteur en scène derrière. Déjà, on va découvrir le texte ensemble. Et puis, à la lecture des trois premières pages, déjà, j’ai dû me plonger moi-même dans les encyclopédies pour comprendre. Parce que, franchement, mes souvenirs de Rousseau-Diderot, c’était un peu… Je connaissais un peu Diderot, parce que j’avais lu Le Paradoxe du Comédien. J’avais lu quelques pièces de lui, Le Neveu De Rameau, tout ça. Donc, quand même, je savais très bien qui c’était. Rousseau, je connaissais L’Homme naturel et bon, la société le corrompt, mais c’est tout. Et puis, au fur et à mesure de la lecture de sa pièce, je m’aperçois qu’en fait, c’est extrêmement documenté, mais qu’il faut quand même avoir un certain bagage. Donc, j’ai commencé à chercher. J’ai commencé à me dire, mais pourquoi il parle de ça ? C’est où ? On en est où dans l’histoire ? Qu’est-ce qui se passe par rapport à la Révolution française, tout ça ? Et puis, tout d’un coup, je l’ai rappelé en disant, écoute, moi, ça m’intéresse, mais c’est beaucoup trop long. Et puis, surtout, si t’es pas extrêmement cultivé, t’es vite largué, quand même. Et il m’a dit, ah bon ? Je dis, bah oui, tu es extrêmement cultivé, toi, mais tout le monde n’est pas comme toi. Et moi, mon but, quand même, dans mon école, dans mon théâtre, c’est de faire venir plus de monde au théâtre et que les gens se sentent bien chez eux au théâtre. Donc, je dis, là, on est parti pour les larguer. Donc, je lui ai proposé de faire la mise en scène. On lui a dit, moi, je propose un truc, c’est que, déjà, on essaie de trouver un lien avec ce qui se passe aujourd’hui. Et puis, surtout, tu coupes. Donc, il a accepté, ce qui est très, très rare, je tiens à le souligner, chez les auteurs.
Marie-Cécile : C’est pour ça qu’il est si triste, en fait.
Grégori : Non, parce que, sans dévoiler la suite, mais on est en train de penser à la suite de ce spectacle. Donc, mais voilà. Après, je lui ai posé plein de trucs. Et puis, on a commencé à délirer. Puis, mon amour de Mel Brooks, de Monty Python, de tous ces gens-là, ça lui a plu. Donc, ça donne ce côté décalé, ce côté plein de surprises. Et puis, il a suivi, surtout. Tout à fait ça, ça l’a fait marrer. Puis, du coup, on est partis tous les deux. Et ce qui est génial, c’est qu’au fur et à mesure de nos séances de travail autour du texte, il repartait en écriture. Il me renvoyait le texte. Moi, ça me donnait des idées de mise en scène. Donc, je disais, tiens, ça me convoque ça. Donc, il repartait en écriture. Et là, en fait, on a super bien bossé comme ça.
Marie-Cécile : Ça a fallu 10 ans pour la faire.
Grégori : Non, mais on a beaucoup bossé.
Franck : Oui, parce qu’à un moment, il y a plusieurs mois où on a répété en distance, même.
Grégori : Carrément en visio. On se voyait, on faisait des séances de répétition en visio. On se voyait régulièrement, plusieurs fois par semaine, voire par mois, tout ça. Et ça a avancé comme ça.
Franck : Et ce qui a permis, justement, un travail de dosage aussi, qui est très important dans la pièce, c’est d’enlever tout ce qui est inutile, …
Marie-Cécile : Ça ne fait pas mal quand on coupe son texte.
Grégori : Surtout que j’en ai presque coupé 50 % quand même.
Franck : Et ce qui est le plus difficile, effectivement, pour un auteur, c’est moins d’écrire, pour moi, que de couper. Oui. Mais après, ça permet d’enlever tout ce qui est… Parce qu’à un moment, dans l’écriture, on peut se dire, on peut apprécier ce qu’on écrit. On peut se laisser bercer par sa propre écriture. En tant qu’auteur, c’est vrai qu’on n’a pas toujours l’idée de l’écho que ça peut avoir chez les lecteurs ou chez les spectateurs. Donc là, en l’occurrence, ça va être le metteur en scène, ils me remet d’équerre par rapport à ce que je veux écrire. Puis ça renforce toujours le sujet et les rapports, surtout parce que, pour moi, c’était avant tout une pièce de rapport.
Grégori : Sur l’altérité, sur l’amitié, sur…
Marie-Cécile : Sur le débat aussi, sur le fait d’être capable de débattre alors qu’on n’est pas d’accord.
Franck : Et voilà, c’est la fameuse phrase de Voltaire, enfin peut-être dite par Voltaire, on n’est pas encore sûrs, vraiment, mais « je ne suis pas d’accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez toujours l’exprimer ». Donc c’est aussi dans cette idée-là que la pièce se situe, c’est-à-dire que l’avis contraire est aussi inspirant.
Marie-Cécile : Et qu’elle résonne aussi beaucoup dans l’actualité, aujourd’hui, on a du mal à débatte.
Grégori : Mais c’est aussi pour ça que ce spectacle m’a beaucoup intéressé. Le travail avec Franck, c’était que… Moi, j’envisage aussi, comme je te le disais, de faire venir les plus jeunes au théâtre. Mais donc, l’idée, c’est d’en faire des scolaires de ce spectacle. C’est que… Que des gamins puissent, à 10, 12 ans, venir voir ça et se dire, non seulement, c’est génial, le théâtre, c’est rigolo, mais en plus, on apprend plein de trucs, et finalement, la philo, j’ai hâte d’en faire, parce que ça va être sympa. Donc si on arrive à faire ça, et pour l’instant, le pari est plutôt gagné, puisqu’on a aussi beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, dès qu’on vend un spectacle pour le tout public, on vend aussi des scolaires, et que l’idée, c’est aussi de reparler du débat. Parce que c’est un peu ce qu’il y a aujourd’hui dans le paysage télévisuel, journalistique. On ne sait plus débattre. Il n’y a plus de débat. Il n’y a plus que des engueulades, en règle, avec des gamins qui défendent leur point de vue sans écouter l’autre, alors qu’un débat, ce n’est pas du tout ça. Et on montre, nous, en une heure et quart aussi, dans cette pièce, comment, à chaque fois, l’un écoute l’autre, et ne fait que rebondir, après apprend, et d’ailleurs change, parce que les deux personnages évoluent au fur et à mesure de la pièce. Et acceptent le point de vue de l’autre, parce que c’est ça aussi, c’est de savoir accepter, que peut-être on a tort, ou que l’autre a raison.
Marie-Cécile : Vous ne vous connaissiez pas forcément avant, si j’ai bien compris ?
Grégori : Non, absolument pas.
Marie-Cécile : Vous avez une super complicité sur scène.
Grégori : Nous sommes des bons comédiens. (rires)
Franck : Non, au fur et à mesure, effectivement, des répétitions m’ont développé un rapport comme ça, qui nous permet de… d’affiner notre relation en tant que personnage, mais aussi en tant qu’acteur. C’est vraiment une pièce où on ne peut pas s’installer à aucun moment, n a vraiment besoin de cette complicité-là.
Grégori : Ce qui était super, c’est que on est vraiment différents, Franck et moi. Et du coup, on a vraiment mis en pratique ce que Franck a mis dans la pièce. C’est qu’on s’écoute, et puis même si on n’a pas forcément tout à fait le même point de vue sur les choses, on respecte l’autre. Et puis finalement, en répétitions, il y a des moments au début, en tout cas, où ça a grincé un peu, parce qu’on s’envoyait nos trucs dans la gueule un peu. Jamais engueulés, mais on défendait nos points de vue. Oui, voilà. Et au début, c’était un peu… Il y avait une ou deux répétitions, on a fini genre, « bon, allez, on va se revoir demain, hein ». Et c’était pas grave. On savait que c’était pas grave. Au fur et à mesure aussi de la mise en scène, et quand on a réinjecté ça dans nos personnages, toutes ces petites choses, en fait, il y a pas mal de nous là-dedans.
Marie-Cécile : Au final, c’était peut-être pas plus mal que vous ne vous connaissiez pas avant, parce que ça a pu aussi créer ça, le fait d’avoir…
Franck : Oui, tout à fait, parce qu’on a deux natures très différentes, deux approches très différentes, et ça a enrichi le personnage de Diderot et de Rousseau.
Leurs recos au OFF :
Celles de Gregori : Trésor National au Théâtre Actuel à 10h & C’est pas du Vélo à la cours du spectateur à 16h
Celle de Franck : Et pendant ce temps Sigmund freudonne au 3S 10th Avenue à 13h50
🎭 RDV à 16h05 à La Fabrique Théâtre – Relâche le mercredi
Mon avis sur le spectacle
Il y a des spectacles qui touchent doucement, profondément, sans bruit — ou presque. Plus jamais Mozart en fait partie. Ce spectacle parle du passé, mais il résonne fort avec notre présent.
Il nous emmène à Venise, dans ses ruelles, portées par de superbes illustrations projetées en vidéo.
Grâce à elles, une forme de légèreté flotte, nourrie aussi par la fraîcheur un peu ingénue de la journaliste venue interviewer Paolo Lévi pour sa toute première grande mission.
Mais très vite, cette légèreté se heurte au récit. Un récit qui traverse l’Histoire et ses zones les plus sombres.
Le violon, joué en direct, devient un personnage à part entière. Il porte ce qui ne peut pas se dire. Il traduit l’émotion, il murmure ce que les mots taisent parfois. Cette adaptation d’un texte initialement destiné au jeune public offre une belle mise à distance. Elle ne gomme rien, mais elle ouvre une brèche.
Une brèche par laquelle peuvent enfin sortir les secrets de l’Histoire avec un grand H, car le secret est une autre forme de mensonge.
L’ouverture de la parole, l’arrêt du silence — c’est sans doute l’un des chemins pour que de telles horreurs ne se reproduisent pas.
Et ce spectacle y contribue, avec justesse, pudeur… et une infinie douceur.
Résumé de l’interview de Jean-Louis Kamoun
Je m’appelle Jean-Louis Kamoun, je suis metteur en scène, comédien évidemment, mais surtout metteur en scène à l’heure actuelle. J’ai fondé aussi l’école du Théâtre Armand, l’école de théâtre. Là, sur le festival d’Avignon, j’ai fait la mise en scène d’un spectacle qui s’appelle Plus jamais Mozart.
La compagnie est basée à Salon-de-Provence, mais on travaille dans tout le département, et on essaie de travailler plus loin. Le festival d’Avignon permet d’avoir des dates dans l’ensemble de la France. On présente donc un spectacle en espérant le faire tourner.
Plus jamais Mozart, c’est l’histoire du plus grand violoniste de notre époque, Paolo Lévi, qui ne joue jamais d’œuvres de Mozart en concert. Pourquoi ? Le spectacle va tâcher de répondre à cette question. On va découvrir plusieurs secrets enchâssés les uns dans les autres, comme des poupées russes. Au début, c’est amusant, puis peu à peu, on descend dans les tréfonds les plus sombres de notre histoire. Et peu à peu, la journaliste chargée d’interviewer Paolo Lévi découvre ses secrets. Elle est tombée au bon moment, au bon endroit… et on apprend la vérité.
Il y a énormément de musique, jouée en live par le violoniste Christian Fromentin. C’est génial de faire écouter du violon solo, c’est un instrument très étonnant.
L’origine du texte
Ce n’est pas un spectacle pour enfants, mais on peut le qualifier de « tout public ». Le texte est de Michael Morpurgo, destiné à l’origine au jeune public, mais moi, je l’ai lu avec beaucoup de plaisir. On a fait des scolaires avec des enfants de 10 ans, ça passe très bien. Il faut juste un petit travail en amont si c’est pour les plus jeunes. Mais les adultes y trouvent aussi leur compte.
L’adaptation et la mise en scène
L’adaptation a été importante, car le livre, ça se lit en une demi-heure. Il a fallu étoffer, tout en restant fidèle. J’ai eu envie de parler de Venise, ville magnifique, et de faire entendre la musique, très présente mais absente du texte. Ça rend l’adaptation légère, mais elle nous mène à la fin de façon agréable.
On a travaillé avec de la vidéo, comme depuis 15 ans avec Olivier Durand. C’est un dessinateur exceptionnel, ses images en noir et blanc donnent une vraie profondeur au spectacle. Et la création a été très collective. Le spectacle a beaucoup évolué. Jean-Marc Michelangeli m’a aidé sur la structure dramatique, Bénédicte Debilly sur le travail avec Christian, notre violoniste, qui n’était pas comédien au départ et qui l’est devenu.
Sa reco au OFF :
Amor à mort à la Nouvelle étincelle à 19h40
🎭 RDV à 13h40 à la Chapelle du Verbe Incarné, Relâche les 11 et 18
Mon avis sur le spectacle
Comment devenir un dictateur ? En voilà une question peu banale à Avignon …
C’est à la Chapelle du Verbe Incarné que j’ai découvert ce spectacle.
Un lieu qui compte pour moi, parce que j’y ai travaillé plusieurs années à la radio. J’y retourne toujours avec curiosité, surtout pour découvrir les compagnies des Outre-mer. Et pour commencer ma découverte de leur programmation, j’ai eu envie de savoir comment devenir une dictatrice … oui j’ai des envies bizarres parfois.
Nans Gourgousse (compagnie H.A.D.), l’auteur et interprète, nous embarque dans un spectacle entre Entre la conférence, la formation à l’américaine et la pièce de théâtre, où Il nous parle des figures du passé, de ce qui les a façonnées et de ce qui pourrait construire le prochain, avec les réseaux sociaux, avec la culture permanente de la peur, avec les raccourcis si faciles à propager.
On rit, on grince des dents, on se rend surtout compte que l’être humain a plein de bonnes raisons de se faire manipuler. Parce que ce qu’il raconte… ça résonne très fort, beaucoup trop fort en ce moment !! Et on se surprend à penser que oui, ça pourrait arriver très vite.
C’est un spectacle intelligent, drôle, bien écrit, très bien documenté.
Ça ne donne pas de leçon, ça pose les faits, notre réalité pour nous mettre face à nous-mêmes, à notre époque, à notre rapport au pouvoir, à l’autorité, à la vérité. Une bonne manière de réveiller les esprits.
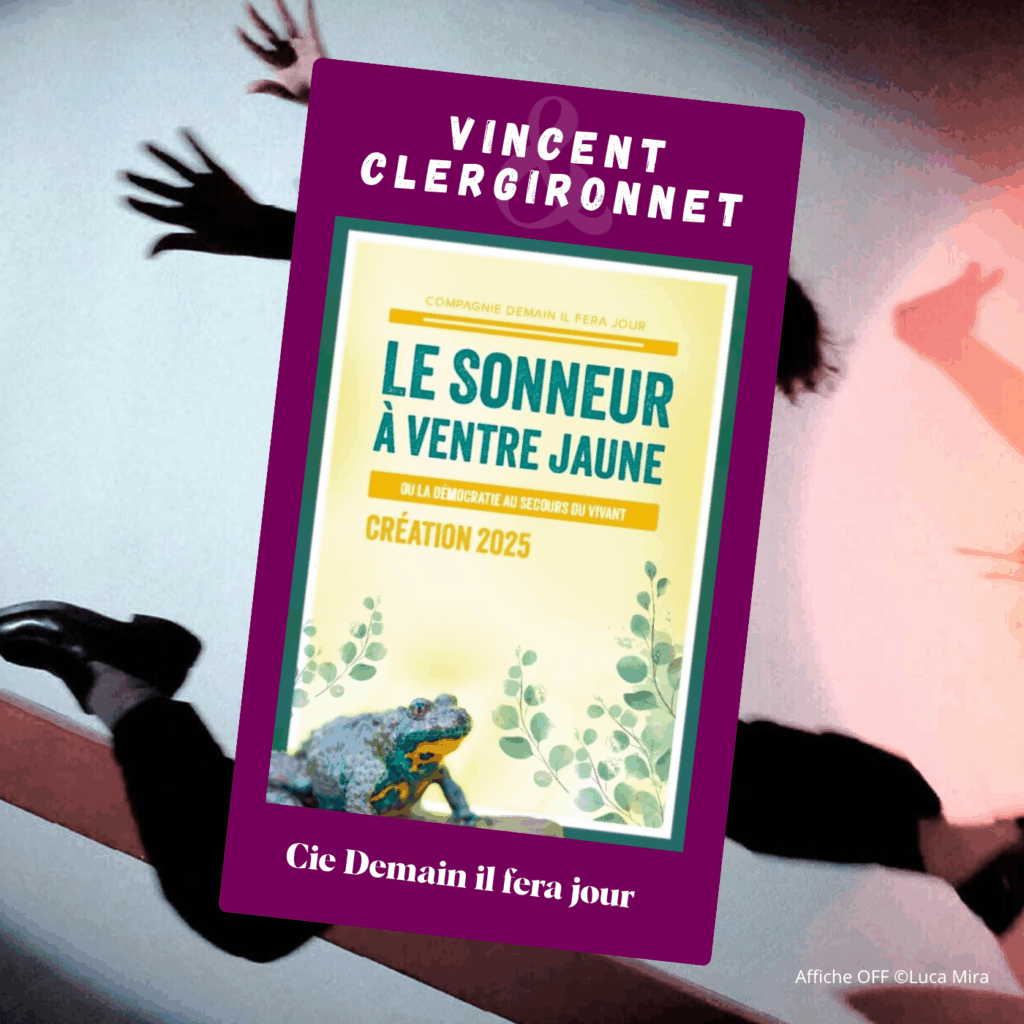
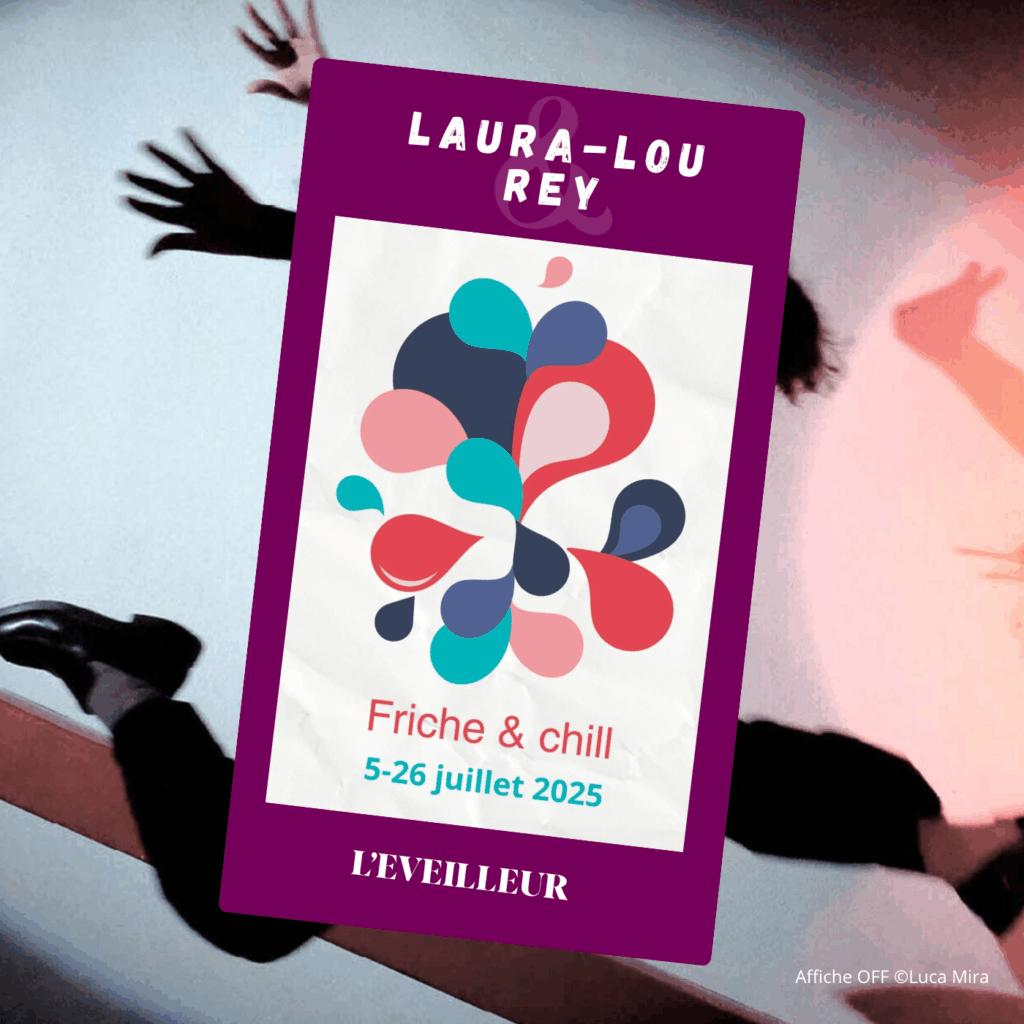

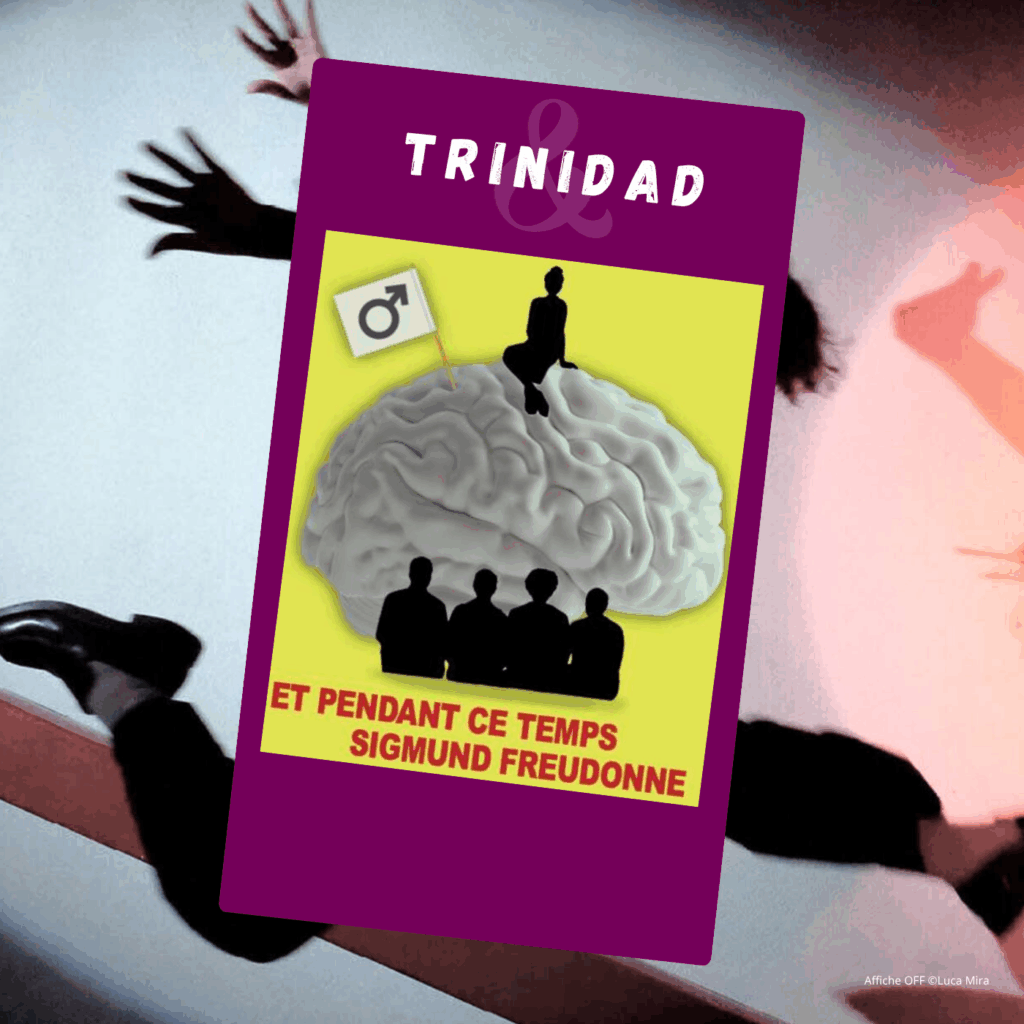
🎭 RDV à l’Université d’Avignon – 10h30 – du 08 au 18 juillet – Relâche les 12, 13 & 14
Mon avis sur le spectacle
Quel plaisir de retrouver l’univers de Vincent Clergironnet, qui nous emmène cette fois dans les forêts ardennaises. C’est un véritable voyage qu’il nous propose, accompagné par le violoncelle d’Éléonore Zielinski. Un voyage où l’on rencontre bien sûr ce petit crapaud au ventre jaune et aux pupilles en forme de cœur, quasiment disparu de ce territoire. Mais c’est surtout un voyage au cœur de nos contradictions humaines, où chacun·e regarde le monde à travers sa propre grille, et peine à accueillir celle des autres.
Et au milieu de tout ça, un petit amphibien de moins de 5 cm, qui devient le révélateur de quelque chose de bien plus vaste qu’un simple passage de camion dans une ornière.
Vincent y signe une sacrée performance, incarnant à lui seul une trentaine de personnages.
La mise en scène, volontairement sobre, nous invite à faire appel à notre imaginaire. Du décor aux lumières en passant par les sièges disposés en cercle, tout est pensé pour créer un espace de pensée et de partage. On rit de nos propres certitudes, on réfléchit, mais cette fois, en laissant aussi une place à la nature et aux non-humains dans le débat.
Un pur bonheur !
Résumé de l’interview de Vincent Clergironnet
Marie-Cécile : Bonjour Vincent. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ?
Vincent Clergironnet : J’aime bien dire que je fais “du théâtre”, parce que ça regroupe beaucoup de choses. Je suis comédien, auteur, metteur en scène, j’ai créé une compagnie – Demain il fera jour – et j’organise un petit festival à Montfavet : le Festival des Petites formes.
Je viens aujourd’hui parler de mon nouveau spectacle : Le sonneur à ventre jaune ou la démocratie au secours du vivant -. C’est l’histoire d’un petit amphibien, entre 3,5 et 5,5 cm, qui se reproduit dans les ornières laissées par les engins forestiers. Il se retrouve bien malgré lui au cœur d’une controverse humaine : doit-on préserver cette espèce ou poursuivre nos activités ?
Marie-Cécile : Tu joues tous les personnages, c’est bien ça ?
Vincent : Oui, je suis seul en scène – enfin presque, je suis accompagné par une musicienne, Éléonore Zielinski, au violoncelle. Il y a une trentaine de personnages, certains n’ont qu’une phrase, mais chaque mot compte. Ce sont souvent des gens que j’ai rencontrés dans le cadre de cette enquête. Ce n’est pas un spectacle de caricatures : les bûcherons, les chasseurs, les scientifiques… ce sont tous des êtres humains avec des contradictions, des évolutions.
Marie-Cécile : Ce spectacle a été créé comment ?
Vincent : À l’origine, c’est une commande de scientifiques dans les Ardennes. On a accumulé une quantité énorme de données sur le sonneur : ses habitudes, sa disparition progressive sur le territoire où il en reste entre 3 à 22 (dans d’autres parties de France, il est encore bien représenté) … Mais mon rôle, c’était de transformer tout ça en théâtre. De faire exister des personnages, de tisser une narration, de garder la poésie.
Marie-Cécile : Pourquoi le monde rural est si présent dans ton travail ?
Vincent : C’est un monde qu’on caricature souvent, y compris dans le milieu culturel. Pourtant, la culture y est partout. Par exemple, j’y ai rencontré des géographes, des passionné·es d’histoire, des gens incroyablement cultivés. Et je trouve important de les rendre visibles, dans leur complexité, leur attachement au territoire, chacun à leur manière.
Marie-Cécile : Le dispositif est un peu particulier aussi ?
Vincent : Oui, on joue dans une agora forestière, en cercle. Le public se retrouve comme pris dans une assemblée qui va devoir délibérer : protège-t-on ou non ce sonneur ? C’est une sorte de tribunal naturaliste… où on invite aussi les plantes et les animaux à “prendre la parole”. Le théâtre devient un lieu pour imaginer d’autres façons de faire société.
Marie-Cécile : Trac, ami ou ennemi ?
Vincent : Ah, mon ami le trac… Il est là, évidemment, mais il me sert. Surtout à Avignon, où il faut faire attention à ne pas se laisser griser par l’effervescence. L’essentiel, c’est la rencontre avec les spectateurs, le moment.
Sa reco au OFF :
Vincent : Nous étions la forêt, Nourrir l’humanité, c’est un métier ou La révérence, tous les trois au Train Bleu, qui interrogent tous notre rapport à la nature et au monde rural. Je pense que ce sont des sujets que les artistes ont encore beaucoup à creuser, avec humilité.
🎭 RDV à 11h40 – Au bout là-bas, relâche les 8, 15, 22 juillet
Mon avis sur le spectacle
J’ai commencé fort ce festival avec une bonne dose d’émotions grâce à Christine et Danser encore. Danser encore c’est une pièce qui nous invite à envoyer valser la mort mais celle qui arrive à l’improviste, celle qui n’est pas vraiment là. C’ est une pièce sur le deuil blanc, celui que l’on doit faire quand un proche est atteint d’une maladie neurologique. Cette pièce parle des étapes par lesquelles on passe dans ces moments de vie, auxquelles on n’est jamais vraiment préparé.
Écrit et interprété par Christine Pedditzi et basé sur son histoire personnelle, c’est une pièce qui nous parle , que l’on ait vécu ce drame ou non. C’est triste bien sûr mais lumineux aussi. Je suis ressortie de la salle bouleversée mais un peu apaisée , d’avoir pu un peu mieux comprendre dans ce qui se joue dans ce type de situation qui nous font peur. Merci Christine d’avoir la force de porter ce spectacle et de partager ton histoire.
Résumé de l’interview de Christine Pedditzi
Je suis Christine, j’ai 57 ans. J’habite à Bédarrides, dans le Vaucluse, depuis 8 ans. On y a créé un lieu dédié à l’improvisation théâtrale, et c’est là que je forme, que je joue, que je crée. Je suis devenue officiellement intermittente du spectacle il y a deux ans, même si ça faisait bien plus longtemps que j’étais sur scène. Cette reconnaissance m’a donné les moyens et la légitimité de créer Danser encore.
Marie-Cécile : Justement, est-ce que tu peux nous parler de ce spectacle ?
Christine : Ce spectacle, je l’ai écrit à partir de mon histoire, celle de ma mère, qui a vécu une dizaine d’années avec Alzheimer. Mais je voulais avant tout parler de ce qui nous reste, malgré la perte : la tendresse, les souvenirs, le fait de pouvoir encore danser, au sens propre comme au figuré.
Marie-Cécile : Et tu dis que tu voulais un spectacle lumineux.
Christine : Oui, même si les premiers jours de répétition, on pleurait tout le temps ! (rires) Mais avec mon metteur en scène, on s’est accrochés à cette idée : les spectateur·ices doivent ressortir avec “les yeux rouges et la banane”. Je ne voulais pas un spectacle qui écrase, mais qui ouvre.
Marie-Cécile : À qui s’adresse le spectacle ?
Christine : À toutes celles et ceux qui aiment, qui ont accompagné un proche malade, qui ont ressenti la fatigue, la culpabilité, l’envie de fuir… Mon moteur, c’était de dire tout ça à voix haute. Parce qu’on ne le dit pas assez. Parce que c’est dur d’assumer qu’on n’a pas envie, parfois. Et qu’on est nombreux·ses à vivre ça.
Marie-Cécile : Tu as fait un vrai travail de recherche aussi ?
Christine : Oui, un an d’interviews avec des familles, des personnes en EHPAD, des soignant·es, des associations comme France Alzheimer 84… Je voulais que ça dépasse mon histoire. Que ça devienne une parole collective.
Marie-Cécile : Tu aurais pu confier le rôle à une autre comédienne. Pourquoi l’as-tu interprété toi-même ?
Christine : Ce n’était pas envisageable autrement. C’était moi ou rien. Ce spectacle, c’est un hommage, un témoignage, une traversée. Je ne me voyais pas laisser ça à quelqu’un d’autre. Et puis, sur scène, je me sens à ma place.
Marie-Cécile : Comment vis-tu le Festival d’Avignon avec un tel spectacle ?
Christine : C’est intense. Le trac est là, le cœur bat à 100 à l’heure, mais je le prends comme une pression positive. Le plus dur, c’est la logistique avant la représentation : régler les lumières, les vidéos, installer… et d’un coup, il faut être complètement présente sur scène. Mais dès que je commence, je me reconnecte à l’essentiel : transmettre. Offrir.
Sa reco au OFF :
Christine : Oui, Improvision à l’Archipel, à 21h40. C’est de l’impro, joyeux, inventif, très bien fait. Ça fait du bien aussi, ce genre de respiration.
🎭 RDV ici pour découvrir tout le programme
Résumé de l’interview de Laura-Lou Rey
Marie-Cécile : Bienvenue dans ce nouvel épisode d’Esperluette en mode Festival. Aujourd’hui, je t’emmène à la découverte d’un lieu un peu caché mais plein de vie : L’Éveilleur, dans le quartier Saint-Ruf à Avignon. Et pour en parler, j’ai tendu le micro à Laura-Lou Rey, cofondatrice du lieu.
Laura-Lou : Je suis cofondatrice de L’Éveilleur, une coopérative culturelle qui accompagne les structures dans leur transition écologique et sociale. À côté de ça, je suis aussi professeure de danse, facilitatrice, et impliquée dans l’association Iguiai Prod, qui anime le lieu avec les habitant·es du quartier.
Marie-Cécile : L’Éveilleur propose un programme très riche pendant le Off, avec Friche & Chill. C’est quoi exactement ?
Laura-Lou : On voulait proposer un contrepoint à l’agitation du centre-ville. L’Éveilleur, c’est une ancienne friche, au calme. Et « chill », parce qu’on y vient pour prendre le temps. On a pensé une programmation douce, locale, inclusive, à la fois artistique et conviviale.
Marie-Cécile : Tu peux nous donner un aperçu des activités ?
Laura-Lou : Le matin, on commence avec des ateliers de réveil dansé, gratuits, que j’anime. Il y a aussi des ateliers créatifs avec des artistes et collectifs comme Le Théâtre des Petites Choses, Pila Project ou La Troupe de l’Éléphant. Et le soir, place aux concerts, aux spectacles et à des surprises artistiques.
On a par exemple :
– Les concerts de Multiprise (rock/punk)
– La patatothérapie, un entre-sorts humoristique avec des patates comme outil de soin (!)
– Le bruit des élytres, un spectacle autour de l’univers de Duras
– Un concert de Léo Merle, artiste avignonnais engagé
– Une fresque participative, à peindre collectivement avec Magali
– Et en fil rouge, une expo poétique de Marie Darodes, avec ses « jardins de poche ».
Marie-Cécile : Comment vous avez préparé ce programme ?
Laura-Lou : On a lancé un appel à candidatures très libre, en accueillant des propositions de spectacles, d’ateliers, de performances. On a dû faire des choix avec un petit budget, en veillant à accueillir surtout des artistes du territoire ou déjà présents à Avignon. L’idée, c’est d’être cohérents avec notre démarche de transition.
Marie-Cécile : Est-ce qu’on a le trac, quand on gère un lieu comme celui-ci ?
Laura-Lou : Oui ! Parce qu’on veut que les artistes soient bien accueillis, qu’il y ait du monde pour voir leurs propositions, qu’ils repartent satisfaits. On veut accompagner leurs envies, dans un contexte où la concurrence est forte. Mais on garde aussi une forme de lâcher-prise : on fait de notre mieux, et on apprend chaque année.
Ss recos au OFF :
Marie-Cécile : Et un coup de cœur à recommander pendant ce Off ?
Laura-Lou : Deux même !
De chair et de feu, un spectacle poétique avec Joël Abadie, un pianiste et moi-même à la danse — un vrai moment de calme à l’Albatros, à 20h45.
La Chienlit, au Train Bleu le 18 juillet seulement : un spectacle joyeux, engagé, à ne pas manquer.
🎭 RDV à au 3S – 10Th Avenue – 13h50 – relâche les 7, 14, 21 juillet
Mon avis sur le spectacle
Une nouvelle fois, Trinidad nous offre un spectacle documenté, drôle, joyeux, qui prône le vivre ensemble. Après le génial Et pendant ce temps Simone veille, cette fois elle fait parler les hommes. Gros défi, puisque le silence fait partie de leur fonctionnement intrinsèque. Et si on ne poser pas de mots sur les souffrance, sur la violence, l’histoire se répète, et je pense que c’est assez visible en ce moment.
Et pendant ce temps Sigmund freudonne permet d’ouvrir cette parole et les yeux , pas pour excuser, pas pour victimiser mais pour casser le cercle vicieux dans lequel nous sommes et avancer ensemble et tenter de construire une société différente. Un spectacle à voir, qui, à mon avis, devrait faire le tour des collèges et des lycées.
Et si vous souhaitez continuer cette réflexion, vous pouvez aller écouter le podcast Ça va faire mâle que Trinidad produit avec l’un des acteurs du spectacle Sébastien Fouillade.
Résumé de l’interview de Trinidad
Marie-Cécile : Bonjour Trinidad ! Tu es de retour à Avignon avec un nouveau spectacle…
Trinidad : Oui ! Et pendant ce temps, Sigmund Freudonne. C’est mon 15ᵉ Off à Avignon. Après Et pendant ce temps Simone veille, je me suis dit : et si on allait écouter les hommes, cette fois ? C’est le pendant masculin. J’avais envie d’explorer leur silence, leurs émotions, leurs blessures. Parce qu’on ne peut pas avancer si on ne pose pas des mots et si on n’essaie pas de le faire ensemble.
Marie-Cécile : Comment t’est venue l’idée ?
Trinidad : C’est parti d’une phrase glissée à l’oreille un soir de 2015 : « Il faudrait que tu fasses la même chose pour les hommes. » L’idée m’a plu. Mais comment faire ? Parce qu’autant trois femmes sur un banc, ça parle. Mais faire parler des hommes ? Alors j’ai creusé. J’ai rencontré des hommes, comme Guy Corneau auteur de Père manquant, fils manqué. Il m’a ouvert des pistes puissantes. Et puis, j’ai observé, j’ai écouté. J’ai vu des hommes blessés par le silence, la guerre, le poids du père, de la virilité. Et j’ai construit mon spectacle autour de ça.
Marie-Cécile : Tu t’es aussi inspirée de rencontres sur le terrain.
Trinidad : Oui. À Tarbes, deux hommes viennent me parler. L’un m’a inspirée pour le personnage de Jacques. Il découvre à la mort de son père qu’il avait été résistant, proche de De Gaulle… Il y avait là une douleur, un décalage, un non-dit. C’est ça qui traverse le spectacle : les silences qui dévastent. Et ces héritages invisibles qui créent des vides, des violences, des enfermements.
Marie-Cécile : Et c’est pour qui, ce spectacle ? Les hommes ? Les femmes ?
Trinidad : Pour tout le monde. Parce que ce qui compte, c’est le lien. Ce que je veux, c’est qu’on ouvre les portes, qu’on prenne les clés. Je tends des clés dans ce spectacle, comme dans mes autres. Après, libre à chacun·e d’ouvrir. Mais il est temps de sortir de ce schéma où les femmes portent tout et où les hommes se taisent.
Marie-Cécile : On y rit ? On y chante ?
Trinidad : Bien sûr ! Il y a de la musique, des chansons, de l’humour. Je ne suis pas là pour faire une thèse. Je veux que les gens ressortent touché·es, mais aussi légers. Dimanche dernier, un homme est venu me demander trois textes : un pour lui, deux pour ses fils. Ça, c’est la plus belle récompense.
Ses recos au OFF :
La raison du plus fou, avec Gregori Baquet & Franck Mercadal, très fin et intelligent.
Et Il y a de la joie, un cabaret joyeux et déjanté à l’Étincelle, un vrai petit bijou.


